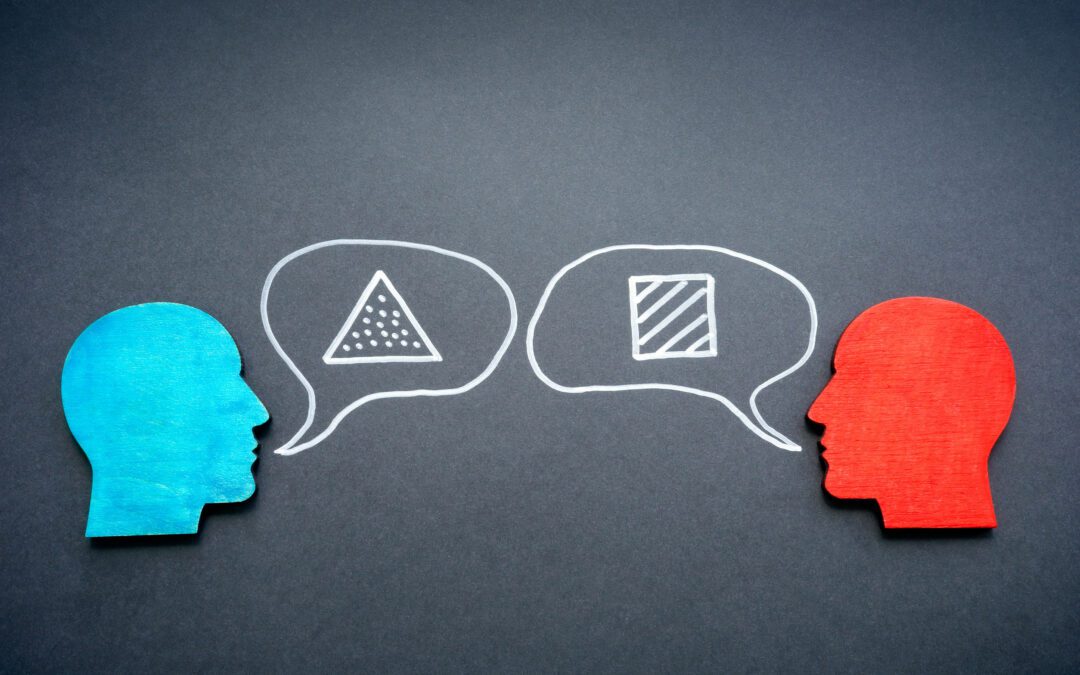par Laëtitia Rudelle | Jan 23, 2025 | Tous les articles, Performance managériale
Comme vous avez pu le lire dans la 1ère partie de cet article (La clé de voute de l’entretien annuel … et de tous les autres), il est essentiel d’adopter une posture assertive et ouverte pour s’assurer que cet entretien se fasse dans un contexte de transparence et de confiance mutuelle.
Au-delà de cet aspect communication, pour être bien mené, l’entretien annuel se doit d’être structuré en séquences dont l’ordre est essentiel pour engager votre collaborateur. Ce sont ces différentes étapes que nous allons parcourir ensemble et ce sont celles sur lesquels nous entrainons nos stagiaires lors de nos formations. Mais, avant toute chose, laissez-moi vous partager les quelques pièges dans lesquels tombent encore de nombreux managers.
Les pièges à éviter
L’expérience professionnelle des formateurs Hominance ainsi que l’immersion chez nos clients nous amènent à identifier un certain nombre de pièges à éviter lorsqu’on se lance dans une campagne d’entretien annuel :
- Profiter de ce moment pour traiter tous les sujets du moment
- Respectez la règle d’or : un entretien, un objectif
- Ignorer la préparation du collaborateur
- L’entretien annuel est un échange de vision qui se doit d’être factuel et fluide. Ne pas prendre en considération la préparation de votre collaborateur rendra votre propre préparation incomplète et vous propulser, par moment, dans l’inconfort.
- Comparer les collaborateurs entre eux
- Chacun de vos collaborateurs est unique et il s’agit de les traiter comme tel. Les resituer dans une moyenne collective est possible, les comparer à untel on évite.
- Se concentrer uniquement sur les points négatifs
- Une des étapes de l’entretien annuel est le bilan et ce dernier se doit d’être complet
- N’avoir en tête que les derniers mois de l’année
- Curieusement, encore beaucoup de nos clients ne formalisent pas les feedbacks qu’ils font tout au long de l’année à leurs collaborateurs (quand ils en font …) ; quand je parle de feedback, je parle de tous ces entretiens individuels pour féliciter, ‘’corriger’’, recadrer, remotiver etc. Et quand je parle de formalisation, je parle de compte-rendu écrit à l’issue de l’entretien. Or, sans ces feedbacks et cette formalisation, comment se rappeler, pour chacun de ses collaborateurs, ce qui s’est passé tout au long de l’année ? Comment être factuel dans ce cas ?
Enfin, le dernier piège est celui d’oublier de structurer son entretien. C’est justement l’objet de cet article ???? vous partager la structure adéquate pour dérouler vos entretiens annuels.
Étape 1 : Prenez le temps de préparer et … de faire préparer
La préparation est la clé de tout entretien (et j’insiste sur TOUT ????). Bien préparer est la garantie d’être agile et efficace tout au long de son entretien. Et c’est valable tant pour le manager que pour le collaborateur.
Mais, que préparer exactement ? et Comment ?
Un bilan … annuel
Comme je l’ai souligné plus haut, l’entretien annuel s’inscrit dans un dispositif plus large de suivi régulier. Tout au long de l’année, vous devez avoir réalisé différents types d’entretiens individuels avec vos collaborateurs dont les objectifs, conclusions et engagements réciproques ont été formalisés.
Il s’agit alors de reprendre l’ensemble de ces compte-rendu afin de réaliser le bilan de cette année écoulée de manière la plus objective possible c’est-à-dire en vous appuyant sur les faits consignés.
Les questions clés à se poser
Afin de cadrer votre réflexion, il y a plusieurs questions à vous poser de manière à disposer des éléments essentiels à votre échange futur.
En voici quelques-unes, la liste n’étant pas exhaustive :
- Sur le bilan de l’année écoulée
Quels sont les objectifs fixés l’année dernière, et ont-ils été atteints ? Si non, pourquoi ?
Quels sont ses succès notables? Comment les a-t-il atteints ?
Quelles difficultés ou obstacles a-t-il rencontrés, et comment les a-t-il gérés ?
Quels comportements ou attitudes ont eu un impact positif sur l’équipe et l’entreprise ?
Y a-t-il eu des axes d’amélioration identifiés l’année passée ? Ont-ils été travaillés ?
- Sur sa performance et ses compétences
Comment j’évalue ses compétences techniques et comportementales ?
Quelles sont les compétences dans lesquelles il excelle ?
Quels sont les domaines où des progrès sont encore nécessaires ?
Comment sa performance se situe-t-elle par rapport à celle de ses pairs ou à mes attentes ?
- Sur sa motivation et sa satisfaction
Qu’est-ce qui semble le motiver le plus dans son travail ? Est-il toujours satisfait ?
Y a-t-il des signes de démotivation, de frustration ou de désengagement ?
Ai-je identifié des opportunités pour renforcer sa motivation ?
- Sa collaboration et ses relations professionnelles
Comment j’évalue la qualité de sa collaboration avec ses collègues ?
Comment se passe la communication entre nous deux ? Y a-t-il des ajustements à apporter ?
Y a-t-il des conflits ou des tensions auxquels il a participé ou qu’il a aidé à résoudre ?
- Son développement professionnel
Quelles sont ses aspirations professionnelles pour les années à venir ?
A-t-il exprimé des besoins en formation ou en développement ?
Existe-t-il des opportunités pour enrichir son rôle ou ses responsabilités ?
- Ses objectifs pour l’année à venir
Quels objectifs puis-je lui fixer pour l’année prochaine ?
Quels indicateurs ou critères permettront d’évaluer la réussite de ces objectifs ?
Quels soutiens ou moyens puis-je lui apporter pour réussir ?
- Son organisation et son équilibre
Sa charge de travail est-elle adaptée ?
Est-il bien organisé dans la gestion de son temps et de ses priorités ?
A-t-il trouvé un bon équilibre entre vie professionnelle et personnelle ?
Pensez bien à relever des éléments factuels qui illustrent l’ensemble de ces points (d’où l’intérêt de disposer de compte-rendu de feedbacks antérieurs ????)
Et la préparation du collaborateur ?
Comme stipulé dans les pièges, il s’agit de guider la préparation de vos collaborateurs et de l’utiliser lors de l’entretien. Les guider dans cet exercice vous garantit qu’ils prennent le temps de se poser, eux aussi, les bonnes questions tant sur leurs résultats de l’année écoulée que sur les aspirations qu’ils peuvent avoir pour celle à venir. Quand je parle d’aspiration, je ne parle pas uniquement de rémunération ???? mais également des objectifs sur lesquels ils envisagent de se challenger et les moyens dont ils ont besoin pour les atteindre.
Anticipez cette préparation avec un rappel à M-1 afin de leur laisser le temps de la réflexion.
Cadrez (bien) votre entretien
Qui n’a pas déjà vécu un entretien annuel qui prend des allures de règlement de compte ? ou de fourre-tout car on profite du moment ? Un entretien qui dure 2 fois plus longtemps que prévu car on s’est dispersé ? Ou un entretien qui vous paraît durer une éternité ?
Bien que nous ne puissions pas nécessairement tout éviter (ou anticiper), cadrer l’entretien est primordial pour
- Limiter toutes les situations citées ci-dessus
- Donner du sens pour le collaborateur sur l’intérêt de ce moment pour lui
- L’engager dans un échange constructif
Il convient donc de prendre quelques minutes pour
- Énoncer l’intérêt pour le collaborateur (évitez le ‘’on est là pour ton entretien annuel, comme tous les ans …’’ ????). Prenez la perspective de l’année à venir en vous appuyant sur son contexte et ses aspirations. Par exemple : ‘’l’objectif de cet échange aujourd’hui est de se donner la vision d’une année plus sereine pour toi » (si nous sommes dans un contexte où le collaborateur a vécu une année »chahutée ».
- Présentez-lui la structure de cet entretien, quelles en sont les différentes séquences qui le compose (réaliser le bilan de l’année écoulée, déterminer les objectifs de l’année à venir etc.)
- Validez le temps imparti et demandez-lui son accord sur tous ces points
J’insiste sur l’obtention de son accord car ce dernier conditionne, en partie, le bon déroulement de l’entretien. En effet, cette démarche s’appuie sur la théorie de l’engagement qui repose sur l’idée que les individus ont tendance à respecter les décisions ou les actions qu’ils ont prises de manière libre et volontaire, car elles engagent leur responsabilité personnelle. En engageant le collaborateur à valider la structuration de l’entretien, celui-ci se sent davantage propriétaire du processus et des décisions prises. Il devient alors plus difficile pour lui de se désengager sans ressentir une forme de dissonance cognitive ou d’inconfort moral. L’implication auprès d’autrui renforce la pression sociale et la cohérence interne, ce qui pousse le collaborateur à respecter les engagements pris, même face à des obstacles.
Pour le manager, il s’agit donc non seulement d’impliquer le collaborateur dans les étapes de l’entretien, mais aussi de lui donner un rôle actif et visible, consolidant ainsi son engagement envers le processus et les objectifs définis.
Dressez le bilan de l’année passée
Dans toutes les formations que nous dispensons chez Hominance, c’est l’étape la plus difficile pour les managers lors des mises en situation. Pourquoi à votre avis ?
Parce que bon nombre de managers ont pour habitude de débuter cette phase en posant leur bilan, leur vision de cette année écoulée. Certains prennent un temps après cela pour interroger le collaborateur sur sa vision, d’autres non …
Or, si en tant que manager, vous commencez par partager votre vision des choses, vous risquez d’activer chez votre collaborateur un des mécanismes de défense détaillé dans la 1ère partie de cet article. Et, à partir de là, l’entretien deviendra beaucoup moins constructif. La conséquence directe sera alors une fixation des objectifs plus difficile et, donc, un manque d’adhésion sur l’année à venir.
La raison s’appuie sur 2 biais cognitifs bien connus : le biais de statu quo et le biais d’endogroupe.
Ces derniers justifie qu’il n’y ait qu’une seule démarche pour réaliser le bilan du collaborateur : le guider par un questionnement efficace pour identifier et prendre conscience de ses succès et de ses échecs.
Je m’explique …
Le biais de statu quo : la résistance au changement imposé
Le biais de statu quo pousse les individus à préférer maintenir les choses telles qu’elles sont. Lorsqu’une correction vient d’une source externe (par exemple, de vous, en tant que manager), votre collaborateur peut instinctivement percevoir cette intervention comme une perturbation de son équilibre mental ou de ses habitudes de travail.
Cette résistance au changement imposé est souvent inconsciente. Si vous dites : « Tu as fait une erreur, voilà ce qu’il faut corriger », votre collaborateur risque de se braquer ou de rationaliser son comportement pour justifier son action. En revanche, en l’encourageant à analyser lui-même son travail et à trouver l’erreur, vous respectez son statu quo initial tout en l’amenant à intégrer progressivement la nécessité d’un changement. Ce processus limite la résistance, car le besoin de correction semble venir de lui-même, et non d’une source externe.
Le biais d’endogroupe : la valorisation des idées personnelles
Le biais d’endogroupe reflète notre tendance à accorder davantage de valeur aux idées ou solutions qui viennent de nous-mêmes ou de notre groupe. En d’autres termes, si votre collaborateur identifie lui-même son erreur et propose une solution, il aura tendance à s’approprier cette démarche et à accorder plus d’importance à son propre raisonnement.
Si, au contraire, vous lui indiquez directement ce qu’il a mal fait et comment le corriger, il risque de ne pas percevoir autant de valeur dans la solution, car elle n’émane pas de lui. En le guidant subtilement pour qu’il arrive à ses propres conclusions, vous renforcez son engagement et sa confiance en ses capacités.
En conclusion Laisser vos collaborateurs identifier leurs propres erreurs n’est pas seulement une question de pédagogie, c’est une stratégie psychologique ancrée dans le fonctionnement de notre cerveau. Respecter leur besoin de maintenir leur statu quo tout en leur permettant de valoriser leurs propres idées garantit une correction plus efficace et durable.
En tant que manager, votre rôle est alors de poser les bonnes questions, de créer un environnement propice à la réflexion et de guider sans imposer. Vous verrez que cette approche, fondée sur ces deux biais cognitifs, renforce non seulement les compétences de vos collaborateurs, mais aussi leur satisfaction et leur autonomie.
À nouveau, je vous engage à consulter notre article très complet sur le sujet du questionnement dans notre blog : ‘’Sachez (bien) questionner’’
Ce bilan N-1 pose les bases pour l’étape suivante : la fixation des objectifs. Au regard de l’ampleur de ce sujet, j’ai décidé d’y dédier un article complet que vous retrouverez dans notre blog dans les semaines à venir.
D’ici là, contactez-nous pour accompagner vos collaborateurs sur cet exercice essentiel qu’est l’entretien annuel.

par Laëtitia Rudelle | Jan 9, 2025 | Tous les articles, Performance managériale, Performance relationnelle
De plus en plus d’entreprises nous sollicitent pour former leurs collaborateurs à l’exercice de l’entretien annuel. Bien qu’il soit aisé de trouver la méthode la plus efficace en surfant sur Google, il l’est beaucoup moins d’adopter la bonne posture en toute circonstance. Or cette dernière conditionne en grande partie l’efficacité de l’entretien. À chaque fois que vous interagissez avec un tiers (ou plusieurs), que vous soyez manager ou non, elle a un impact sur la façon dont est perçu votre message. Et elle peut parfois être dévastatrice malgré une intention positive de départ.
Comment réagir face à un collaborateur qui se surestime ou un qui n’accepte pas le feedback ? Comment ne pas se laisser émotionnellement dépasser ? Comment bien réagir face à une situation déconcertante ? Ou, tout simplement, comment bien passer ses messages ?
Pas toujours évident surtout lorsqu’on sait que plus de 3 salariés sur 10 (31%) ne se sentent pas en mesure de s’exprimer librement pendant leurs entretiens annuels (étude Welcome to the jungle).
C’est pourquoi, dans cette première partie, c’est sur cette fameuse posture que je vais porter mon attention. La seconde partie de l’article, la semaine prochaine, sera dédiée à la méthode.
Adoptez une posture assertive en toute circonstance
L’assertivité … un terme tellement galvaudé que très peu de nos stagiaires arrivent à en donner une définition lors des formations que nous animons. Et pourtant ce dernier est né la première moitié du XXè siècle. Plus tout jeune mais encore tellement d’actualité ????
Sans entrer dans son étymologie anglosaxonne, l’assertivité désigne la capacité à exprimer ses opinions en respectant celles d’autrui, sans tomber dans les comportements de défense que notre cerveau active automatiquement lorsqu’il se sent en danger.
En bref, dire ce que l’on pense avec les formes ????
En fait, cette notion s’appuie sur celle des positions de vie initiées par Eric Berne, fondateur de l’analyse transactionnelle. Ce modèle psychologique a été développé dans les années 50 pour mieux comprendre notre personnalité et celle des autres, les rapports sociaux et la communication de manière générale. On y parle alors de transaction entre les individus pour illustrer leur façon de communiquer. La position de vie d’une personne est donc liée à la valeur qu’elle s’accorde à elle-même et celle qu’elle accorde aux autres à un moment donné.
L’assertivité s’appuie donc sur ce qu’Éric Berne appelle la position +/+ : j’ai de la valeur et tu as de la valeur c’est-à-dire que je me respecte et je te respecte, je m’accepte tel que je suis avec mes forces et mes faiblesses et je t’accepte tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses. Cette position permet une communication coopérative et saine.
Les comportements de défense à éviter
Pour autant, il n’est pas toujours évident de rester constamment dans cette posture. Parfois ça titille un peu, notamment lorsque nous sommes fatigués ou sous pression. Nous ne sommes pas des robots tout de même et heureusement ???? De ce fait, parfois nous tombons dans des comportements négatifs, guidés par notre instinct de survie qui ressent un danger imminent.
Ils sont au nombre de 3 :
- Le comportement de lutte, celui qui agresse.
Ce comportement correspond à la position de vie +/- : j’ai de la valeur, tu n’en n’as pas. Il s’illustre par des intensités variables ; un individu en état de lutte va pouvoir, par exemple, s’impatienter, vous couper la parole, faire preuve d’ironie, vous accuser, hurler, vous menacer ou vous dévaloriser.
- Le comportement de soumission, celui qui fuit voire abandonne
Le comportement de fuite correspond à la position de vie -/+ : je n’ai pas de valeur mais, vous, vous en avez. Dans ce cas, votre interlocuteur peut manifester divers comportements : changer de sujet, se disperser au cours de la conversation, éluder vos questions voire les ignorer ou éviter de se retrouver en votre présence
Le comportement d’abandon correspond plutôt à la position -/- : aucun de nous deux n’a de valeur. Il peut s’illustrer par le retrait la dévalorisation, l’immobilisation, la plainte voire la victimisation pouvant aller jusqu’à la déprime.
- Le comportement de manipulation, celui qui essaie de vous faire croire que vous êtes seul responsable
Ce comportement correspond à la position de vie +/- : j’ai de la valeur, tu n’en n’as pas. Le principe est de vous amener à douter voire à faire quelque chose qui sera à l’encontre de vos intérêts. Pour ce faire, l’individu peut se défausser, vous culpabiliser, être de mauvaise foi voire mentir.
La difficulté est que, dès lors que vous adoptez l’un de ces comportements, vous poussez votre interlocuteur à se réfugier, lui aussi, dans son comportement refuge. Un jeu de pouvoir s’engage alors et la communication est rompue.
Les caractéristiques d’une posture assertive
La posture assertive concerne donc bien le fond et la forme du message. Il ne s’agit pas de convaincre son interlocuteur coûte que coûte afin de l’amener à sa propre vision des choses mais bien d’instaurer une communication fondée sur la collaboration, la recherche de compromis afin de satisfaire les intérêts de chacun.
Pour ce faire, restez le plus clair possible afin d’éviter l’activation du comportement de défense de votre interlocuteur. Restez factuel pour éviter de tomber dans le registre des opinions, ces dernières n’engageant que celui qui la prononce. Abstenez-vous également de ponctuer vos propos de bémols comme ceux de quantité (un peu, un petit peu, assez) ou les bémols temporels (parfois, souvent, toujours …)
Soyez (réellement) en écoute active
Il est fréquent que nos stagiaires, durant nos formations, affirment disposer d’une écoute active et, quelques tests leur confirment qu’ils ne sont pas exempts de tomber dans les pièges de l’écoute ????
Les pièges de l’écoute
Ils sont nombreux, laissez-moi vous présenter les principaux.
- Généraliser : rapprocher une situation présente à une situation passée ressemblante et y apporter la même réponse sans prendre en considération les différences.
- Sélectionner : sélectionner quelques informations dans les propos de son interlocuteur, celles qui font sens pour nous, les traiter au travers de nos propres filtres et restituer une réponse erronée car une partie des informations essentielles nous a échappé
- Interpréter : filtrer les propos de son interlocuteur au travers de ses propres croyances et y apporter notre propre vision des choses sans comprendre la vision de l’autre.
- Spéculer : déjà se faire une idée de ce que l’autre va répondre, voire penser (c’est bien connu, nous sommes tous télépathes ????, ce qui peut nous amener à passer à côté du véritable message ou des nuances importantes de la conversation.
- Penser à sa réponse pendant que votre interlocuteur s’exprime. Il a été prouvé par de nombreuses études scientifiques qu’il est impossible de mener deux tâches simultanées sans brève interruption inconsciente de l’attention. Le cerveau peut ainsi manquer certaines informations et perdre le fil de son cheminement. Ce phénomène de ‘’clignement attentionnel’’ a été observé par Sergent, Baillet et Deahene en 2005.
- Négliger le langage non verbal et penser que ‘’qui ne dit mot consent’’. En effet, le poids du non verbal dans la communication est essentiel. Sans tomber dans le mythe des 93% des travaux de Mehrabian (lui-même expliquant les dérives dans l’exploitation de son étude), il est évident que notre corps parle. Prenons l’exemple d’un profil DISC dont la Vert domine : extrêmement discret et soucieux des autres, c’est un profil qui exprime peu ses désaccords ou ses doutes. En revanche, son visage, lui, parle. Si vous ne captez pas cela, vous risquez de passer à côté du fond de sa pensées et de vous méprendre sur son engagement.
Tous ces pièges et beaucoup d’autres encore sont précisément les points sur lesquels nous entraînons nos clients durant nos formations. Selon notre profil, chacun d’entre nous a une prédilection pour certains pièges plutôt que d’autres et seul l’entraînement vous permettra de les corriger.
Les clés d’une bonne écoute active
En attendant de venir nous entrainer avec nous ????, voici quelques pistes pour améliorer votre écoute.
- Apprenez à faire silence, dans votre tête autant qu’avec votre bouche.
- Ne cherchez pas à apporter des solutions (et donc à y penser pendant que votre interlocuteur vous parle …). Écoutez pour comprendre et non pour agir.
- Prenez le temps de réfléchir avant de répondre, évaluez les propos de votre interlocuteur qui, contrairement à ce qu’on peut croire, n’a pas nécessairement la volonté de nous piéger.
- Évitez de juger ce que vit l’autre au travers de nos propres croyances, de banaliser ce qu’il vit ou de comparer par rapport à votre propre situation qui est évidemment différente.
- Quittez le ’’je-me-moi’’ pour concentrer entièrement votre attention sur la personne qui vous parle. Au moment où l’autre vous parle, pardonnez-moi, mais on se fiche de votre vie, votre œuvre (une expression qu’entendent souvent mes stagiaires ????
Pour conclure, une bonne écoute active passe également par la capacité à comprendre la façon dont son interlocuteur fonctionne, sa personnalité, sa vision du monde, ses peurs et ses besoins. En faisant cela, cela nous donne la certitude d’exprimer notre message dans le bon langage, celui de l’autre. On appelle ça plus communément se synchroniser. Attention, je ne parle pas de singer l’autre ce qui aurait, évidemment, un effet pervers, mais bien d’aligner votre communication sur les 3 leviers de communication (verbal, non verbal et paraverbal) de votre interlocuteur.
Et, le DISC est un formidable outil pour détecter les différents profils de personnalités et s’y adapter.
Si vous souhaitez plus d’information sur nos formations DISC, contactez-nous.
Faites preuve d’empathie
Tout entretien individuel, qu’il soit professionnel ou non, peut parfois susciter de fortes émotions. Il ne s’agit pas de juger les émotions ressenties par chacun des protagonistes mais bien de les comprendre et de les accueillir.
Attention, les accueillir ne signifie pas se contenter d’un vague ‘’je comprends’’ pour ensuite passer à l’objectif de l’entretien ???? je le souligne car vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où j’ai ce type de réponse en jeu de rôle lors des formations que j’anime ????
L’empathie, c’est la capacité à comprendre les sentiments, les ressentis et les pensées de l’autre de manière sincère et authentique.
L’écoute active permet de comprendre l’autre et de s’y adapter, l’empathie permet de le faire sans juger de sa perception du monde et sans chercher à calquer sa propre perception des choses sur son interlocuteur.
Pour enrichir ce qui a déjà été dit en écoute active, voici quelques conseils pour développer votre empathie :
- Apprenez à identifier les différentes émotions et leurs signaux. Des formations existent ???? contactez-nous pour en savoir plus
- Restez sincère et authentique dans votre approche
- Adoptez une attitude chaleureuse et accueillante en restant connecté à votre interlocuteur durant l’échange
- Soyez vigilant dans votre communication et, notamment, les mots employés
- Apprenez à décrypter le langage non verbal au travers de formation en synergologie
- Et, enfin, ce que nous travaillons beaucoup lors de nos formations, identifiez l’intention positive de votre interlocuteur à savoir ce qui le pousse (réellement) à agir. Quel besoin cherche-t-il à satisfaire ?
Faire preuve d’empathie nécessite de savoir prendre suffisamment de recul pour éviter de se laisser contaminer par les émotions de l’autre.
Apprenez à (vraiment) questionner
Savoir poser des questions utiles atteste justement d’une alliance écoute active – empathie efficace.
Attention à ne pas vous laisser influencer par cette croyance ancestrale : ‘’ne posez que des questions ouvertes’’. Cette dichotomie question ouverte – question fermée n’a plus lieu d’être. Selon les différents profils (DISC par exemple), certaines personnalités auront besoin de questions fermées pour débuter une conversation et se mettre en confiance. D’autres, plus bavards, se contenteront d’une seule question pour se livrer (un peu trop d’ailleurs parfois ????).
De la même manière, nous illustrons souvent le questionnement par la méthode QQOQCP (Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi). Encore une fois, pensez plutôt à l’utilité de la question et, surtout, à qui vous la posez. Par exemple, certaines personnalités peuvent se sentir agressées avec un devoir de justification lorsqu’elles reçoivent des questions débutant par ‘’Pourquoi … ?’’
Il existe plusieurs types de questions utiles. Vous retrouverez un article très complet sur le sujet dans notre blog : ‘’Sachez (bien) questionner’’
Vous l’avez compris, la posture est essentielle pour créer un climat de confiance et engager ders échanges constructifs. Car, et c’est notre postulat chez Hominance, rien de sert de connaître les différentes méthodes d’entretien individuel si vous ne savez pas communiquer.
Si vous souhaitez faire travailler vos Managers sur leur posture, contactez-nous. Et retrouvez-nous, la semaine prochaine, pour la suite cet article.

par Laëtitia Rudelle | Oct 31, 2024 | Tous les articles, Performance managériale, Performance relationnelle
Je souris à l’énoncé même du titre que j’ai défini pour ce nouvel article ???? avec un profil DISC à dominante Rouge-Jaune, autant vous dire que le lâcher-prise a été un de mes axes de travail pendant de nombreuses années. Alors, vous me direz, lâcher-prise ok mais sur quoi exactement ? Et puis, on fait comment ? C’est ce que nous allons investiguer ensemble …
Lâcher-prise, de quoi parle-t-on ?
Connaissez-vous Stephen Covey ? L’auteur du livre ‘’Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu’ils entreprennent’’. Dans ce livre, Stephen Covey nous partage ce qu’il a appelé les cercles d’influence. Ce qu’il pointe c’est le temps que nous passons à essayer de contrôler des choses sur lesquels nous n’exerçons aucune influence. Cette notion de contrôle pouvant passer par de la ‘’simple’’ rumination qui, évidemment, nous coûte beaucoup d’énergie et génère de la frustration, à un contrôle pur et dur des situations vécues. Parce que le ‘’lâcher-prise’’ c’est aussi une démarche psychologique : comment j’arrive à mettre de côté les éléments sur lesquels je n’ai aucune influence et comment je me concentre sur ce sur quoi je peux agir.
Imaginez la situation suivante : vous aviez prévu depuis longtemps un super pique-nique avec tous vos amis que vous n’avez pas vu depuis longtemps et qui, pour certains, viennent de loin. Le jour J arrive et il pleut des cordes sans discontinuer. Lâcher-prise c’est accepter ce sur quoi vous n’avez aucun pouvoir (la météo) et trouver la solution alternative qui vous convient le mieux sans entamer la joie de retrouver vos amis. Quelle que soit la solution que vous choisissez d’appliquer vous l’aurez décidé sans perdre votre énergie à rechigner et vous profiterez de votre journée.
La première étape du lâcher-prise est d’accepter que vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout ce qui vous entoure. C’est purement et simplement impossible. Vous ne pouvez agir que ce sur qui dépend de vous.
Lâcher-prise, c’est donc avoir ce recul sur les choses afin de déterminer quelle serait l’action la plus efficace à réaliser pour modifier/améliorer la situation, le tout sans susciter d’émotions négatives qui ont un effet néfaste sur votre système immunitaire.
Savez-vous d’ailleurs que, pour 1 minute de colère, il faut 1h à votre système immunitaire pour évacuer votre cortisol ? Or un niveau élevé de cortisol dégrade le cerveau et les autres systèmes de l’organisme ce qui peut alors susciter un certain nombre de problèmes de santé comme les troubles anxieux, des troubles digestifs ou une perte de mémoire. Pas très attirant, n’est-ce-pas ?
Mais, est-ce si facile de lâcher-prise ?
Inégaux face au lâcher-prise
Les peurs qui se cachent derrière la dimension de contrôle
Il est fréquent que, dans mes articles, je revienne sur le mode de fonctionnement du cerveau humain. Cette unité centrale est quand même celle qui gère l’ensemble de nos comportements … et, justement, il est essentiel de rappeler que c’est notre cerveau primitif qui impulse nos premières réactions, avant même que l’information soit transmise à notre cerveau rationnel qui peut ensuite tempérer et rationnaliser. Or, le premier filtre de notre cerveau primitif est de déterminer s’il y a danger ou non ce qui le fera agir en conséquence.
Et sur quoi se fonde notre perception du danger ? Sur nos peurs évidemment.
Derrière le contrôle, il peut donc se cacher plusieurs peurs :
- La peur de l’échec ou, tout simplement, de ne pas être parfait
- La peur de perdre sa crédibilité (notre ego en somme) vis-à-vis des personnes qui nous entourent
- La peur de manquer
- La peur de s’exposer
- La peur de faire de la peine
- La peur de ne pas/plus être aimé(e)
- La peur d’être dominé etc.
Et ces peurs sont souvent bien ancrées, depuis longtemps, dans votre subconscient. Ce sont elles qui guident votre besoin absolu de (tout) contrôler.
C’est pourquoi, mon premier conseil si vous réalisez qu’il est temps de lâcher (un peu) prise c’est d’identifier ces peurs et les croyances qui y sont associées. Les sources sont nombreuses : notre éducation, notre environnement social/géographique/culturel, nos expériences passées …
Pour vous guider dans cette identification, posez vous 2 questions :
- ‘’Quels pourraient-être les conséquences négatives si j’arrivais à… ?’’. Par exemple, si j’arrivais à dire à mon Manager que je ne suis pas d’accord avec lui. Si je lui dis, il se peut que cela suscite un échange houleux voire un conflit. Derrière cet évitement du conflit peut se cacher la peur du rejet ou la peur de l’abandon.
- ‘’Quels peuvent être les effets positifs si je reste dans cette situation ?’’. Admettons que je refuse toute forme de projet qui m’apparaît comme complexe afin de me protéger d’un risque d’échec alors on peut imaginer la peur de ne pas être parfait ou, tout simplement, à la hauteur et, donc, d’être jugé(e) comme incapable.
Identifier ses peurs c’est être en capacité de changer ses comportements afin que ces derniers deviennent plus écologiques pour vous et, ainsi, lâcher-prise sur votre dimension de contrôle. Car, si je reprends les cercles d’influence de Covey, autant nous n’avons aucune influence sur les événements extérieurs, autant nous en avons sur nous-mêmes à savoir nos réactions, nos pensées, nos attentes.
Si vous souhaitez approfondir cette démarche, vous pouvez solliciter un coach et/ou un thérapeute.
Une forte influence des personnalités DISC
Au risque de décevoir les personnalités dont le Bleu domine, la perfection n’existe pas ???? Nous avons tous nos peurs, plus ou moins conscientes. De ce fait, nous cherchons tous à ‘’contrôler’’ quelque chose :
- Un dominant Rouge va chercher à contrôler le résultat afin que ce dernier soit rapide et efficace.
- Un dominant Bleu va chercher à contrôler la qualité du résultat en s’assurant que ce dernier a bien été atteint dans le respect strict des règles et procédures en place.
- Un dominant Vert cherche plutôt à préserver l’harmonie et la prévisibilité de son environnement.
- Un dominant Jaune, quant à lui, cherche à contrôler la reconnaissance et l’Amour de son entourage. Toutes ses actions seront alors orientées vers cette maîtrise.
Je vous rappelle néanmoins, et c’est toute la richesse du modèle DISC, que plus de 60% des profils ont 2 couleurs dites dominantes. De ce fait, selon les associations, certains comportements peuvent être exacerbés comme d’autres atténués.
Si le sujet vous intéresse, contactez-nous.
Qu’est-ce que le lâcher-prise induit ? Et, comment faire ?
Les bénéfices du lâcher-prise
Avant de vous parler des bienfaits je tiens à rappeler une chose importante : lâcher-prise n’est pas tomber dans l’indifférence la plus totale et rester passif face à toutes ces situations qui nous mettent dans l’inconfort. Que l’on s’entende.
Lâcher-prise, c’est accepter qu’une situation ne vous convienne pas et vous demander ce que vous pouvez mettre en place pour faire en sorte de la vivre différemment.
Lâcher-prise, c’est éviter de gaspiller son énergie à ruminer, s’énerver ou s’attrister et, donc, gagner en efficacité (et en bien-être ????) grâce à de nouvelles stratégies efficaces.
Et les bienfaits, pour votre entourage (personnel comme professionnel) sont nombreux :
- Accroître l’autonomie et laisser libre court à la prise d’initiative
- Développer la collaboration spontanée
- Renforcer l’esprit d’équipe et l’entraide
- Développer un état d’esprit responsable voire entrepreneurial
Quant aux bénéfices pour vous-même, est-ce vraiment nécessaire de les rappeler ? Tout ce qui s’inscrit dans un véritable bien-être psychologique et physique.
Les risques à mal le faire
Je vous partage une situation que j’ai vécue récemment lors d’un de mes accompagnements managériaux. Le manager que je coachais avait un N+1 très contrôlant qui, à chaque fois qu’il confiait une mission à mon coaché, repassait systématiquement derrière lui pour refaire tout ou en partie le travail demandé. Qu’a décidé de faire le manager coaché d’après vous ? et bien il a cessé de faire en me partageant une réalité : ‘’de tout façon, il va refaire derrière moi alors, à quoi bon que je me démène et perde du temps ?!’’. Évidemment, le fait qu’il ne fasse plus a suscité beaucoup de colère de la part du N+1 ce qui a, in fine, engendré de fortes tensions entre les deux protagonistes. En fait, le N+1 avait l’impression de lâcher-prise en déléguant de nouvelles tâches à son collaborateur mais reprenait le contrôle dès que ce dernier avait fini de produire. Pendant ce temps-là, le collaborateur perdait peu à peu sa motivation à agir.
Les risques à rester dans le contrôle sont nombreux et impactent l’ensemble des protagonistes.
Détecter un Manager contrôlant
Plusieurs indices peuvent vous mettre la puce à l’oreille pour détecter un Manager contrôlant :
- Il vous impose son niveau d’exigence excessive. Très soucieux du détail, il estime que sa façon de faire est la meilleure : ‘’Laisse-moi relire avant d’envoyer ton mail. Houlà ! tu ne peux pas le dire comme çà, écris plutôt ça’’
- Il est en surveillance constante de ce que vous faites : ‘’Je t’ai vu avec Untel, vous parliez de quoi ?’’ ou ‘’Fais voir comment tu as fait ça’’
- Il ignore les feedbacks (que vous avez eu le courage de faire) : ‘’Je suis comme ça, c’est à prendre ou à laisser’’ ou ‘’J’ai toujours fonctionné comme ça’’
- Il critique constamment vos idées et vos initiatives car seule sa vision des choses est valable : ‘’Ce n’est pas la bonne solution, il faut faire comme ça’’ ou ‘’Je ne suis pas d’accord, ma façon de faire est plus efficace’’
Cette liste n’est pas exhaustive et je suis sûre que vous trouverez plein d’autres illustrations ????
Les clés pour lâcher-prise
Les premiers conseils que nous pouvons nous donner pour maîtriser notre irrésistible envie de contrôle lorsque celui-ci pointe le bout de son nez sont les suivants :
- Prendre le temps de respirer.
- Réfléchir avant d’agir. Envisager la situation dans sa globalité, sous toutes ses facettes, vous permet de trier ce sur quoi vous avez de l’influence et le reste.
- Envisager des solutions alternatives à celles déjà tentées puisque ces dernières ont probablement été dans la droite lignée du contrôle.
Pour revenir à la dimension managériale, le lâcher-prise s’illustre au travers de plusieurs comportements :
- Accorder le droit à l’erreur. Lâcher-prise, c’est considérer que l’erreur est une opportunité d’apprentissage pour vos collaborateurs. Évidemment, votre rôle est de déterminer ce sur quoi l’erreur est envisageable et sera bénéfique pour votre collaborateur. Il ne s’agit pas non plus de le couler d’autant que, selon le profil DISC de ce dernier, l’erreur ne sera pas vécue de la même manière.
- Instaurer une communication transparente et bienveillante au sein de votre équipe. Vos collaborateurs doivent pouvoir tout vous dire sans craindre d’être jugés ou réprimandés. C’est ce climat de confiance réciproque qui vous permettra d’avoir de la visibilité et, donc, indirectement d’être rassuré sur ce qu’il se passe. De la même manière, je conseille souvent aux Managers que j’accompagne de partager leur mode de fonctionnement à leurs collaborateurs. Ainsi, ces derniers sauront ce dont vous avez besoin pour être rassuré ce qui limitera votre envie dev reprendre le contrôle ????
- Définir des objectifs réalisables. Si vos collaborateurs font face à des objectifs inatteignables il y a de fortes chances qu’ils se découragent et cessent d’essayer de les atteindre. Ce qui pourrait alors réveiller vos velléités de contrôle …
- Faire confiance. Depuis la mise en place du télétravail, cette dimension a été presque imposée aux Managers. Comment continuer à animer ses équipes en évitant le micro-management ? Pas simple pour les plus contrôlants …
En conclusion, prendre du recul c’est savoir s’adapter et arrêter de s’obstiner à conformer la réalité et les autres à notre réalité. En bref, acceptez que tout ne se passe pas comme vous l’avez prévu !
Il s’agit de trouver un juste équilibre entre le besoin de contrôle et la liberté que l’on se donne à lâcher du lest sur la vie en. Se posant une unique question : que puis-je mettre en place pour, à terme, être plus serein et confiant au quotidien ????
Pas simple, n’est-ce pas ?
Si vous souhaitez être accompagné pour apprendre à lâcher-prise, contactez-nous.

par Laëtitia Rudelle | Oct 10, 2024 | Tous les articles, Performance managériale
Lorsque vous sollicitez un plombier pour une fuite d’eau, allez-vous lui demander également de revoir l’électricité ? Où demandez-vous une baguette à votre boucher ? bon, je vous avoue que cela m’est arrivé juste pour plaisanter … surtout quand il me dit ‘’alors ma brave dame, que puis-je faire pour vous aujourd’hui ?’’… ‘’et bien, mon brave Monsieur, mettez-moi une baguette bien cuite s’il vous plaît’’.
Trêve de plaisanterie. Cette discussion je l’ai eue avec de nombreux chef d’entreprise qui me sollicitaient pour former leurs Managers au management. Et à l’issue de la formation, bon nombre de ces Managers ressortent enthousiastes et avec une boîte à outils opérationnelles mais également frustrés de ne pas pouvoir tout mettre en oeuvre pour accompagner correctement leurs collaborateurs. Or, rappelons-nous, que selon une récente étude menée par Gallup, 50% des salariés quittent leur poste à cause de leur Manager. 1 sur 2 … cela laisse à réfléchir lorsqu’on sait la difficulté à recruter certains profils.
Alors, je ne suis pas complètement bornée (quoique ????), je peux comprendre l’intérêt d’avoir un Manager qui produit également. Cependant, comme tout prisme, il y a aussi une facette qui présente les inconvénients d’une telle pratique.
Alors, plongeons nous dans ce vaste sujet des Managers Producteurs. Pour ce faire, nous allons l’envisager sous la houlette d’un manager commercial mais cela est tout autant transposable sous celle d’un service R&D, technique, logistique ou quoi que ce soit d’autre.
Les bonnes (ou moins bonnes) raisons d’instaurer cette double fonction
Pourquoi demandez-vous à vos managers commerciaux/ales de gérer également un portefeuille clients ?
Voici les bonnes (ou moins bonnes excuses) que j’entends régulièrement :
- ‘’Il sait faire, il/elle a été commercial(e) avant’’ … oui, d’ailleurs c’est pour ça qu’il/elle va bien rester dans sa zone de confort et continuer à faire ce qu’il/elle faisait si bien : vendre.
- ‘’Ces clients-là, ils sont importants, il ne faut pas les perdre’’ … vos commerciaux sont à ce point mauvais ?
- ‘’Il faut bien donner l’exemple’’… un très bon exemple pour les futur(e)s commerciaux/ales qui prendront un jour un rôle de manager en effet. Sans compter l’impact sur l’engagement et la fidélité des troupes.
- ‘’Nous n’avons pas le budget pour recruter’’… et le budget, vous n’êtes pas près de l’avoir si vos commerciaux ne sont pas correctement accompagnés pour générer de la croissance.
Oui, je sais, je suis un peu piquante mais c’est pour votre bien ???? Néanmoins, À l’écoute de toutes ces justifications, j’ai tendance à en tirer la conclusion suivante : manager n’est donc pas toujours considéré comme un métier dans les organisations commerciales. C’est un rôle secondaire, à faire quand, ou si, on a le temps.
Car c’est bien le message que reçoivent ces Managers : fais du chiffre et, à l’occasion, encadre ton équipe. Une belle injonction paradoxale d’autant qu’on leur demande, en plus, d’être des Managers collaboratifs, bienveillants etc. Pas évident de choisir son camp entre Vente et Management.
Le pire est que, souvent, les chefs d’entreprise se rendent vite compte que l’encadrement laisse à désirer. Une conclusion qu’ils tirent dès que le chiffre n’est pas au rendez-vous. Et là, le Manager doit rendre des comptes : ‘’Pourquoi le taux de transformation est si faible ?’’ »’Mais ils ne prospectent pas (assez) tes commerciaux !’ » »Pourquoi a-t-on perdu le client X ?! »’ »’Et le CRM ? Ils ne le remplissent pas le CRM ?!!!’ »
Et, souvent, le N+1 brandit la baguette magique : ‘’Tu vas aller faire une formation en Management, cela va t’aider’’.
La baguette magique (supposée) de la formation
Entendons-nous, évidemment qu’une formation en management va les aider ! Encore plus lorsqu’ils sont propulsés Manager car ils étaient d’excellents commerciaux (ce qui est fréquent …). Dès lors qu’on envisage un accompagnement sur le moyen terme, un trio formation/retour d’expérience/ coaching, alliant collectif et individuel, ils en ressortent grandis, c’est une certitude. Ils repartent avec des outils, de l’entraînement et des plans d’actions managériaux bien ficelés. Et regonflés à bloc !
Car Manager, cela s’apprend … comme tout autre métier. Les méthodes de management, c’est-à-dire les compétences techniques, s’acquièrent. En revanche, les compétences relationnelles, elles, se développent. Pour cela, il faut d’abord s’assurer du ‘’potentiel’’ du futur Manager. Dispose-t-il des fameuses soft skills indispensables ? Rien de plus simple à vérifier avec le passage d’un test décryptant ses comportements et attitudes, véritables reflets de ses valeurs et de sa personnalité.
Ensuite, il s’agit de s’assurer que votre collaborateur/ice a bien pris conscience qu’une posture de Manager nécessite de nouvelles habitudes, de nouveaux mécanismes. Si ce n’est pas le cas alors, dans un premier temps, le coaching sera plus adapté que la formation. La résistance au changement est une attitude, consciente ou inconsciente, bien naturelle. Elle se lève dès lors qu’un accompagnement est mis en place.
Et, des entreprises qui mettent les moyens pour donner à leurs Managers le plus de chances possibles pour bien manager, il y en a. Et c’est tout à leur honneur d’investir dans la montée en compétences de leurs collaborateurs. Seulement, si le Manager n’est pas libéré de son temps de producteur alors je vous dirais ‘’à quoi bon ?’’
Évidemment, ce n’est pas systématique et général, vous connaissez mon sens de l’extrême ????
Le risque, néanmoins, après avoir investi dans la montée en compétences de vos collaborateurs, est que ces derniers se perdent à nouveau dans la gestion des urgences commerciales (dans le cas d’un Manager commercial), se laissent déborder par les Clients de leur portefeuille et, de fait, perdent vite leur enthousiasme, leur motivation et leur engagement. Et, finalement, qu’ils découvrent la frustration de ne pas pouvoir accompagner correctement leurs équipes.
Que faire alors si vous n’avez pas le choix ?
Que l’on s’entende, être Manager producteur peut avoir des avantages et, pour certains profils DISC, peut même être nécessaire.
Le rôle de Manager producteur et les profils DISC
Je vais traiter ce point sous l’angle de la mono couleur, pour plus de simplicité. Pour autant, et je le répète constamment en formation, un profil DISC avec une seule couleur et les autres à plat, cela n’existe pas. Un profil DISC est une combinaison des 4 couleurs, différente selon tout à chacun. Et c’est l’association de certaines couleurs entre elles qui fera qu’un comportement pourra être renforcé ou atténué, de façon positive ou moins agréable. Ce sont ces nuances que nous abordons également dans nos formations afin d’éviter que nos stagiaires tombent dans le piège de cataloguer ses interlocuteurs dans un prisme unique et figé.
Reprenons maintenant le fil de notre histoire …
Lorsque j’anime des formations Management, ce sont les profils à dominante bleue qui, les premiers, me disent : »je dois moi-même maîtriser ce que font mes collaborateurs pour être crédible à mon poste de manager ». Et oui, ces profils sont des experts avant tout, avec un haut niveau d’exigence en termes de qualité de rendu et très contrôlants. Au point d’ailleurs de faire »à la place de » ou, pire, de »(RE)faire derrière » leurs collaborateurs. Ils se plongent donc avec délice dans la production en pensant prouver alors leurs qualités de manager…
Les profils à dominante rouge peuvent avoir la même difficulté à lâcher prise (imaginez un profil Rouge/Bleu ou Bleu/Rouge ????) mais, cette fois, pour s’assurer de produire vite. Ils se plongent alors avec délice dans la producteur car c’est un défi rapide à relever et que cela leur assure des résultats immédiats.
Les profils à dominante verte peuvent, eux aussi, tomber dans le piège de la production, au détriment du management et ce, pour 2 raisons. La première est qu’ils ne savent pas (ou peu) dire non car leur vocation est de se rendre utile aux autres afin de préserver l’harmonie du groupe. Altruistes et très tolérants, il leur arrive donc de »faire à la place » en pensant sauver un collaborateur d’une charge de travail estimée comme trop conséquente ou de »réparer » une tâche mal réalisée afin d’éviter toute source de conflit. De ce fait, il est nécéssaire pour lui de savoir faire.
Concernant les profils à dominante jaune, des profils optimistes et enthousiastes, ils peuvent parfois se réfugier dans la production afin d’éviter d’affronter les mauvaises nouvelles ou les situations difficiles à gérer. Et puis, très créatifs et champions des solutions alternatives, c’est leur moyen à eux de tester de nouvelles choses afin d’éviter l’ennui.
Au final, tous peuvent parfois privilégier la production au détriment du management. Leurs raisons s’entendent. Le meilleur moyen d’éviter cela est alors de les accompagner dans leur propre développement :
- Apprendre à un dominant Vert à rester ferme dans ses demandes et recadrer si nécessaire
- Apprendre aux dominants Bleu et Rouge à lâcher-prise et à donner une vraie autonomie à leurs collaborateurs, en leur accordant le droit à l’erreur
- Apprendre à un dominant Jaune à affronter certaines situations managériales difficiles
La bonne alliance des 2 fonctions
Des Managers Producteurs nous en accompagnons dans beaucoup de domaine : en immobilier, en recrutement ou dans le domaine bancaire. Et, bien sûr, que cela peut fonctionner. Par expérience, nous constatons que le meilleur moyen d’allier les 2 fonctions est déjà de donner aux managers les moyens pour être plus efficaces tant en termes d’outils que d’accompagnement et de temps.
Et puis, parfois un Manager estime ne pas être à la hauteur alors qu’un inventaire 360° illustre la satisfaction de ses collaborateurs … Il est donc important, pour vous, de bien poser vos attentes et votre exigence. N’oubliez pas que certains profils DISC sont très très exigeants envers eux-mêmes et pose la barre très haut.
Alors, si vous voulez mesurer la performance de vos Managers et mettre en place un accompagnement personnalisé, contactez-nous !

par Laëtitia Rudelle | Sep 26, 2024 | Tous les articles, Performance managériale
Voyons ensemble comment piloter au mieux la performance individuelle de chacun des profils de votre équipe pour tirer le meilleur de chaque collaborateur.
Beaucoup de Managers que nous rencontrons en formation ou en coaching nous avouent être complètement débordés et soumis à des exigences multiples. Il leur est demandé d’être de plus en plus performants, polyvalents, souples et réactifs, dans un contexte concurrentiel toujours plus exigeant. Alors peu prennent le temps de formaliser la montée en compétences de leurs collaborateurs et, encore moins, de réaliser un diagnostic complet de leur niveau de performance en amont.
Or, il apparaît difficile d’avoir un plan d’actions managérial pertinent si ce dernier ne repose pas sur une analyse fine des leviers de la performance et d’indicateurs de suivi définis.
Les 4 piliers d’un diagnostic de performance efficace
L’étape préalable, avant de réaliser votre diagnostic puis de mettre en place une stratégie d’action, est d’identifier les compétences nécessaires à chaque poste au sein de votre équipe. Elles peuvent être techniques (hard skills), relationnelles et comportementales (soft skills) ou organisationnelles.
S’intègre ensuite la notion de motivation, c’est-à-dire les aspirations du collaborateur. Vous pouvez, en effet, disposer de toutes les compétences pour assurer vos missions mais ne plus avoir réellement envie de le faire. Et, c’est sur la base de ces 4 éléments que vous pourrez alors réaliser votre diagnostic de performance.
Compétences techniques (hard skills)
Il s’agit des savoir-faire essentiels pour assurer les tâches spécifiques liées au poste. Par exemple, dans le cas d’un commercial, il devra maîtriser l’art du questionnement.
Compétences relationnelles et comportementales (soft skills)
Elles sont nombreuses et englobent la capacité à travailler en équipe, à gérer le stress, l’adaptabilité, les qualités de leadership, la communication, etc. Dans le cas précédent, savoir poser des questions utiles est étroitement lié à l’écoute active.
Compétences organisationnelles
La gestion du temps, la planification de projet, la gestion des ressources et la communication sont quelques-unes des qualités organisationnelles à identifier. Toujours dans le même exemple, un commercial doit savoir gérer les différentes étapes de son process de vente tout en organisant ses tournées de façon optimale.
La motivation
L’observation du comportement d’un collaborateur est le meilleur indicateur pour connaître son niveau de motivation. Semble-t-il engagé, productif ? Une façon de cerner ce qui le motive est de le questionner sur ses attentes et ses aspirations au travail notamment dans des moments où il donne le meilleur de lui-même. Les leviers de motivation et leur poids diffèrent selon le profil du collaborateur. Il va donc s’agir d’identifier ce qui prime parmi les leviers suivants : la reconnaissance, la clarté, les missions et la charge de travail, l’implication, l’autonomie et la cohésion. Ou allez encore plus loin en analysant les forces motrices de leur profil DISC.
Vous souhaitez réaliser le diagnostic de vos collaborateurs ? Contactez-nous.
Comment accompagner la montée en compétence de vos collaborateurs ?
Accompagner la montée en compétence d’un collaborateur, c’est d’abord miser sur ses points forts pour maximiser son potentiel. En capitalisant sur ses talents naturels, le manager multiplie les chances d’en tirer le meilleur. Il ne s’agit pas uniquement d’évaluer ses aptitudes professionnelles (forces et faiblesses). Vous devez aussi discerner ses qualités humaines et personnelles (exubérance ou timidité, capacité à prendre la parole en public, à sociabiliser avec le reste de l’équipe, etc.). Pour autant, cela ne signifie pas qu’il faille abandonner la montée en compétences sur les zones d’inconfort chez vos collaborateurs. Vous pouvez tout à fait le faire travailler sur ces points mais surtout sous un angle spécifique et en vous limitant à un ou deux items, pas davantage.
Identifiez ses points forts
- Évaluations et tests de compétences
Utilisez un outil comme la méthode DISC, pour identifier les talents naturels et les points d’inconfort de votre collaborateur. Ce sont des outils précieux pour ce genre d’exercice !
Recueillez les avis de ses collègues et supérieurs pour obtenir un panorama complet de ses compétences et de ses forces mais également des attentes non satisfaites de l’équipe concernée.
Encouragez le collaborateur à réfléchir à ses succès passés et aux tâches qu’il trouve particulièrement motivantes ou satisfaisantes. Cet exercice est toujours très intéressant lorsqu’il est couplé à un 360° afin d’identifier les différences de perception.
Développez un plan personnalisé
- Fixez des objectifs MALINS
Définissez des objectifs qui s’appuient sur des critères simples mais néanmoins essentiels :
- Mesurables avec des indicateurs définis
- Ambitieux mais Atteignables c’est-à-dire qui s’appuient sur un historique et/ou des données marché
- Limités dans le temps donc avec des échéances claires
- Individualisés car tous vos collaborateurs n’auront pas les mêmes besoins pour les atteindre
- Négociables car certains profils vont vous challenger et il s’agira de savoir ce sur quoi vous êtes prêts à faire un effort
- Stimulants pour donner du sens en vous appuyant sur le QiPM de chacun de vos collaborateurs
En réalité, l’idéal, pour favoriser leur appropriation, est de les co-construire avec votre collaborateur.
Élaborez un plan détaillé qui inclut des étapes spécifiques, des ressources nécessaires et des délais pour atteindre les objectifs fixés. Au-delà de l’importance de formaliser son plan d’action, ce dernier permet également de piloter l’activité des membres de votre équipe.
Vous souhaitez être accompagné pour établir des plans d’action pérennes ? Contactez-nous.
Formez et coachez
Proposez des formations et des ateliers qui confortent les points forts identifiés tout en intégrant des compétences supplémentaires.
Mettez en place des sessions de coaching régulières pour l’aider à exploiter ses points forts de manière optimale et à surmonter ses défis.
Créez un environnement de soutien
- Culture de reconnaissance
J’ai coutume de dire, lors de mes accompagnements, que nous avons tous besoin de reconnaissance. Ce qui diffère, de vous à moi, c’est à la fois l’intensité et ce sur quoi nous avons besoin d’être reconnu. Sans cette information, tous vos efforts pourraient être vains.
Associez le collaborateur à un mentor. Il pourra l’aider à développer ses compétences en lui fournissant des conseils et des retours d’expérience.
Évaluez et ajustez régulièrement
Fournissez-lui un retour d’information régulier sur les progrès accomplis, en soulignant ses réussites et les domaines à améliorer. Au-delà de la notion de feedback, cet échange régulier est un véritable signe de reconnaissance et une attente forte des nouvelles générations (pas que évidemment ????)
Vous souhaitez apprendre à vos managers à réaliser des feedbacks efficaces ? ? Contactez-nous.
- Réévaluation des objectifs
Réévaluez régulièrement les objectifs et le plan de développement pour s’assurer qu’ils restent pertinents et alignés avec les évolutions du collaborateur et de l’entreprise. Aujourd’hui, notre monde VUCA nous impose de rester cohérent dans les objectifs fixés à nos équipes et nous enjoint à, parfois, un peu de flexibilité. Un entretien mi-année est le minimum syndical pour garantir le maintien de l’engagement et de la motivation des collaborateurs.
Encouragez l’autonomie et la responsabilité
- Autonomie dans le travail
Donnez-lui la latitude nécessaire pour prendre des décisions et mener à bien des projets. Cela ne peut que renforcer sa confiance et son engagement. Attention néanmoins, laisser de l’autonomie sans considérer l’erreur comme source d’apprentissage serait contre-productif. De la même manière, il m’est arrivé il y a peu de coacher un collaborateur qui avait cessé de prendre des décisions car son N+1 revenait systématiquement dessus. Ce dernier lui avait, certes, laissé le droit de prendre des responsabilités mais repassait derrière lui à chaque fois qu’il estimait que sa méthode était la meilleure. Je vous laisse deviner le profil DISC du N+1 ???? Finalement, le collaborateur a fini par quitter l’entreprise.
- Responsabilité des résultats
Encouragez-le à se sentir responsable de ses résultats. C’est une bonne manière de renforcer sa motivation, son sentiment d’accomplissement, et son sentiment d’appartenance à l’entreprise. Si ces derniers ne sont pas encore au niveau de vos attentes, engagez votre collaborateur à faire son auto-bilan sur la base du questionnement C.A.C.A (la prochaine fois, dans cette même situation, qu’est-ce que je Continue à faire ? qu’est-ce que j’Arrête de faire ? qu’est-ce que je Commence à faire ? qu’est-ce que j’Améliore ?)
Fournissez des ressources et du soutien
- Accès aux ressources nécessaires
Assurez-vous que vos collaborateurs aient accès aux ressources nécessaires, telles que des outils, des formations et des informations. Pour cela, pensez bien à vous appuyer sur les techniques d’apprentissage des couleurs DISC. Nous n’apprenons pas tous de la même manière.
Maintenez un soutien constant de la part des managers et de l’équipe en offrant des conseils et en facilitant l’accès aux opportunités de développement.
Favorisez un apprentissage continu
- Culture de l’apprentissage
Promouvez une culture où l’apprentissage continu est valorisé et encouragé, véritable sésame de toutes les sociétés innovantes.
- Programmes de développement
Proposez des programmes de développement continu qui intègrent les nouvelles compétences et les tendances du secteur.
En adoptant cette approche centrée sur les points forts, vous pouvez non seulement aider vos collaborateurs à développer leurs compétences de manière plus efficace, mais aussi à améliorer leur engagement, leur bien-être et leur satisfaction au travail, contribuant ainsi à la performance globale de l’entreprise.Vous souhaitez en savoir plus sur la manière de mettre en pratique ces solutions ? Rejoignez-nous sur https://hominance.com/notre-accompagnement/formation-performance-manageriale/.

par Laëtitia Rudelle | Avr 4, 2024 | Tous les articles, Performance managériale
J’ai la chance d’intervenir dans bon nombre de secteurs d’activités (industrie, médical, cosmétique, immobilier, banque, assurance, media, recrutement etc.) auprès de profils bien différents (managers, commerciaux, comptables, marketers …) et de tout âge. Et, bien souvent, j’entends parler de la difficulté à fidéliser voire tout simplement manager les nouvelles générations, ceux que nous appelons communément ‘’les jeunes’’. De là à être confrontée à de fortes croyances du type ‘’la nouvelle génération, ils ne bossent pas et ils sont ingérables’’, il n’y a qu’un pas.
Je me suis donc dit qu’il pourrait être aidant, pour certains d’entre vous, de disposer d’un ‘’mode d’emploi’’ pour accompagner nos jeunes générations à s’épanouir, eux aussi, dans nos entreprises.
Générations, de quoi parle-t-on ?
Bien que les intervalles de date diffèrent d’un expert à un autre, on considère qu’une génération s’étale sur 15 ans. On parle donc de
- Génération X 1960-1979
- Génération Y 1980-1994
- Génération Z 1995-2009
- Génération Alpha 2010-2025
À partir de 2025, nous parlerons de génération Bêta ce qui, de mon point de vue, n’est pas un terme très bien pensé (tout le monde ne l’assimilera pas à la ‘’simple’’ lettre grecque, j’en suis persuadée).
Je tiens à rappeler aux détracteurs (oui le mot est un peu fort j’en conviens) des générations Z et Alpha que, déjà il y a 2500 ans, Socrate disait des jeunes de l’époque ‘’Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l’autorité et n’ont aucun respect pour l’âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans’’ . J’ai l’impression d’entendre un Boomer (1945-1959) ????????
Bref. Plongeons maintenant dans les us et coutumes de ces ‘’jeunes’’ que nous critiquons autant que nous les adorons (je vous rappelle que, pour certains d’entre nous, ce sont nos enfants ????)
Mais qui sont-ils ?
Je vous propose de partir de la génération X (la précédente étant majoritairement en retraite et en plus c’est la mienne ????) afin de disposer d’un comparatif pour les suivantes.
J’ai pris le parti de vous dresser le portrait de ces générations sans tenir compte (pour une fois ????) des différentes personnalités DISC. Ces dernières sont, évidemment, à prendre en considération mais je ne voulais pas complexifier la donne.En revanche, lors de nos formations, nous croisons les données afin d’établir un plan d’accompagnement personnalisé pour chacun des collaborateurs concernés.
La Génération X (1960-1979)
Leurs forces
Ces collaborateurs d’expérience (et oui, ils sont sur le marché du travail depuis un petit bout de temps quand même …) ont été ‘’élevés’’ à la sauce reporting en étant très concentrés sur le résultat et les moyens de l’atteindre. Je n’irais pas jusqu’à dire qu’ils sont capables de porter des objectifs sans y trouver de sens car, si c’était le cas, il n’y aurait pas autant de quinquas qui quittent l’entreprise pour se mettre à leur compte …
Quoiqu’il en soit, la génération X reste très pyramidale dans sa conception de l’entreprise et, donc, de l’autorité. Une culture de la hiérarchie encore très présente avec un principe d’autorité fort (qu’on soit d’accord avec ce dernier ou pas d’ailleurs).
Leurs difficultés
Cette génération est très individualiste (et à la fois, nous le sommes tous ???? il vous suffit de lire la première partie de mon article Managers, dopez vos rituels 2024 pour comprendre que c’est ce qui nous a sauvé la vie depuis des milliards d’années) ce qui leur confère peu de transparence et des capacités en communication plus restreintes que les générations suivantes. Une petite culture du ‘’non-dit’’ peut-être ? ????
La Génération Y (1980-1994)
Leurs forces
Également appelée les Millennials, la génération Y dispose de capacités d’adaptation plus grandes que celles de ses prédécesseurs. Bien plus autonomes, ils deviennent moins résistants au changement car plus agiles et plus ouverts d’esprit. Leur force est également de parfaitement maîtriser les outils technologiques.
Leurs difficultés
Encore plus égocentrés que la génération précédente, les collaborateurs Y ont un engagement dans le collectif faible et sont plutôt dans la culture du donnant-donnant : ‘’je veux bien faire quelque chose pour toi si toi tu fais quelque chose pour moi’’.
Une de leur grande difficulté est de se plier à l’autorité instaurée par la hiérarchie et il devient difficile de faire jouer le principe d’autorité avec eux.
Leur forte exigence d’équilibre pro/perso peut être considérée comme un atout car ils savent se préserver et se ressourcer tout comme une difficulté (pour les autres notamment) car ils orientent leurs choix et donc leurs priorités en ce sens, au détriment parfois des objectifs de l’entreprise.
La Génération Z (1995-2009)
Leurs forces
Cette génération, dernière entrée sur le marché du travail (enfin pour les plus vieux d’entre eux), est celle que l’on a appelé les zappeurs, terme peu glorieux j’en conviens. En réalité, leur ultra connexion leur permet une rapidité de pensée et d’action qui peut vite vous dépasser. Ils sont l’illustration même du tout, tout de suite.
Multifonctions, ils fonctionnent en réseaux à condition que ces derniers partagent leurs valeurs. Cash, ils disent ce qu’ils pensent, sans s’embarrasser de la personne à qui ils s’adressent.
Leurs difficultés
Cette ultra connexion et leur volonté de tout apprendre vite et de toucher à tout est le reflet de leur impatience et de leur dispersion. ‘’Tout et tout de suite’’ pourrait être leur slogan. Extrêmement exigeants à l’égard de leur hiérarchie, ils considèrent tout membre de l’entreprise comme un égal ce qui génère parfois quelques problématiques notamment pour leur manager s’il adopte un mode trop directif.
Une ressource incroyable … à condition de savoir les motiver
Et oui car, ce n’est pas le tout de comprendre ce qu’ils peuvent amener à l’entreprise mais encore faut-il savoir les engager et les fidéliser.
La Génération X (1960-1979)
Pour beaucoup d’entre eux (en fait d’entre nous ????) il reste encore de longues années avant la retraite. Ce qui signifie qu’au-delà de bénéficier de leur expérience il est encore temps de développer leur potentiel ce qui est un vrai besoin de leur part. Continuer à ‘’grandir’’ pour rester une ressource utile est essentiel aux yeux de cette génération.
Ces collaborateurs se distinguent également par leur forte implication au quotidien et ils apprécient qu’on les reconnaisse pour ça.
Enfin valorisez leur performance !
La Génération Y (1980-1994)
La génération Y est la première qui exprime son besoin d’avoir un environnement de travail confortable et flexible. Ce sont également les premiers à chercher l’alignement entre leurs valeurs et le sens de leur travail. Leur mot d’ordre : épanouissement au travail.
Misez donc sur un environnement de travail familial, amical et douillet au sein duquel ils seront accueillis avec soin lors de leur intégration.
De plus, contrairement à la génération précédente, les Millennials sont davantage motivés par ce qu’on appelle la motivation intrinsèque c’est-à-dire celle qui se rattache à la gratification de soi-même et, donc, au plaisir à effectuer la tâche confiée. Or, difficile de prendre du plaisir au travail dans un environnement défavorable.
Cet épanouissement personnel (et assez autocentré il faut le dire) passe par la liberté d’entreprendre. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils apprécient tout particulièrement qu’on reconnaisse leur créativité, leur travail et leur participation.
En bref, dans l’idéal, il faudrait les laisser tester, toucher à tout et, surtout, dans la plus grande des autonomies. Évidemment, cela sous-entend d’avoir instauré une confiance forte fondée sur leur capacité à s’autodiscipliner et partager pour l’intérêt du collectif.
La Génération Z (1995-2009)
Ces fameux Gen Z qui soucient tant les X dans le monde de l’entreprise (attendez de récupérer les Alpha ????)…
Alors que leurs prédécesseurs privilégient la notion de plaisir et d’épanouissement, la génération Z, elle, s’attache à l’impact social et environnemental de leur job. Impossible pour eux de travailler sans porter leur attention sur les enjeux sociétaux. Ils veulent savoir pourquoi ils font les choses et en quoi il contribue.
Pour autant, ils ont un point commun avec Millennials : l’importance de disposer d’un cadre de travail convivial, confortable et d’une ambiance agréable.
Néanmoins, ils tiennent à leur équilibre de vie pro/perso ce qui en fait les premiers adeptes du travail hybride. Pas question de s’oublier et de tout donner à leur entreprise.
Enfin, avides d’apprendre, les Gen Z attendent qu’on leur offre des opportunités de développement et qu’on leur fasse confiance pour relever de nouveaux défis. Ils ont d’ailleurs besoin d’être impliqués dans les décisions, qu’on leur demande leur avis, bref qu’on s’intéresse à eux en tant que personne. D’ailleurs, un manager n’a leur respect que si ce dernier a une valeur ajoutée dans leurs apprentissages. C’est aussi la raison pour laquelle ils sont demandeurs de feedbacks réguliers tout en étant très vigilant à la forme de la communication. Rappelez-vous qu’ils considèrent tout le monde sur un pied d’égalité ????
En conclusion, chacune des générations a ses exigences et ses besoins. En revanche, toutes ont besoin de reconnaissance.
Pour les engager et les fidéliser, il suffit de disposer du mode d’emploi ????
Si le sujet vous intéresse, contactez-nous.