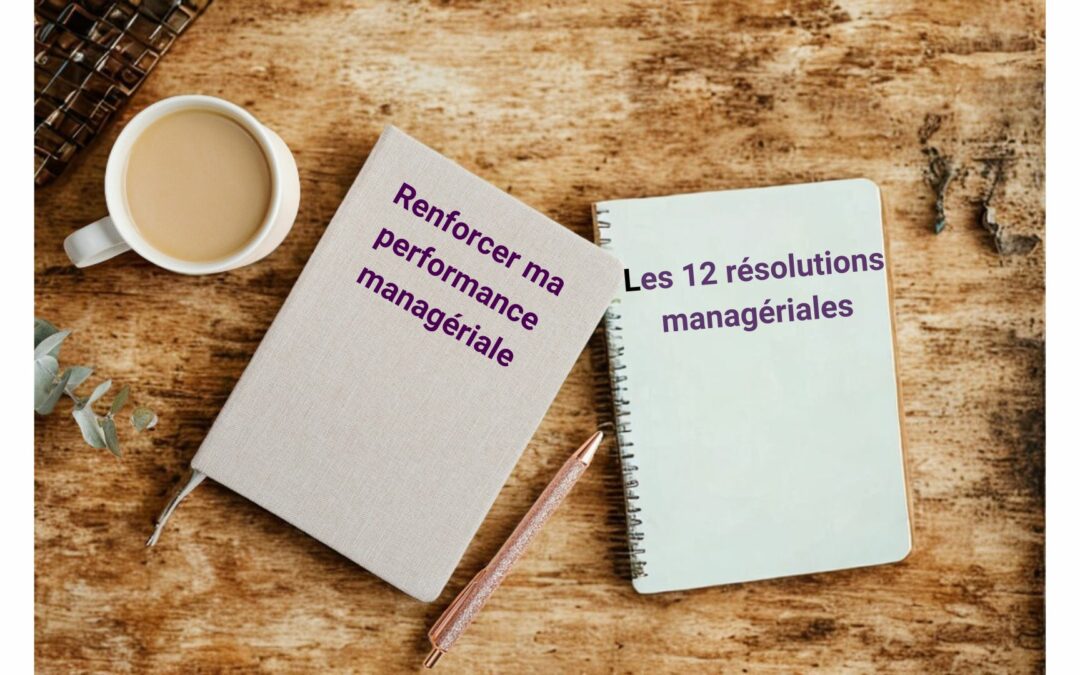par Laëtitia Rudelle | Août 30, 2025 | Tous les articles, Performance managériale
Au gré de mes accompagnements, je rencontre de plus en plus d’organisations matricielles, dans lesquelles les silos tombent et où les projets s’hybrident.
Dans ce contexte, est apparu un profil managérial essentiel : le manager transverse.
Il n’a pas d’autorité hiérarchique… mais il doit mobiliser, embarquer, faire avancer. Sans pouvoir, il doit exercer de l’influence. Sans titre, il doit incarner du leadership.
Et ce n’est pas toujours simple. Les Managers transverses que j’accompagne me partagent souvent les mêmes difficultés ou les mêmes craintes :
- ‘’Je n’arrive pas à lui faire comprendre que c’est essentiel pour la boîte’’
- ‘’Ils sont déjà sous l’eau, comment les mobiliser sur un projet qui ne verra le jour que dans 6 mois ?!’’
- ‘’Son manager ne me soutient même pas sous prétexte que c’est une demande du siège’’
- ‘’Il m’a clairement dit que ce n’était pas sa priorité, je fais quoi ?’’
- ‘’Cela fait 15 fois que je lui demande la même chose mais aucun retour’’
Et bien d’autres encore.
Heureusement, il y a des leviers à activer et des compétences à mobiliser pour performer dans ce rôle.
Le paradoxe du management transverse
Le manager transverse coordonne des acteurs sur lesquels il n’a aucune autorité directe. Il pilote des projets, anime des collectifs, harmonise des pratiques ou des priorités entre métiers, demande des reportings en local pour consolidation… tout cela sans lien hiérarchique formel.
Il se heurte alors à un double défi :
- Faire avancer sans pouvoir imposer
- Convaincre sans pouvoir contraindre
Le risque ? Devenir un ‘’chef d’orchestre sans baguette’’
Mais bien utilisé, ce positionnement est une formidable opportunité de leadership : car quand on ne peut pas s’appuyer sur la hiérarchie, on est obligé de s’appuyer sur la relation, la vision et la posture.
Les 3 leviers du leadership d’influence
L’influence ne repose pas sur le statut, mais sur la capacité à mobiliser des dynamiques internes chez l’autre. Elle s’appuie sur trois leviers fondamentaux :
La légitimité
« Pourquoi devrais-je t’écouter, toi plutôt qu’un autre ? »
La légitimité du manager transverse ne vient pas de son poste, mais :
- de sa compétence perçue (expertise, maîtrise du sujet)
- de sa posture relationnelle (assertivité, écoute, clarté)
- de sa capacité à incarner la vision du projet
Lorsque j’accompagne des managers transverses, mon 1er conseil est le suivant : adoptez une posture de “partenaire de valeur”, pas de “porteur de reporting”.
Par expérience, cela change radicalement la dynamique de relation.
La crédibilité
« Est-ce que je peux te faire confiance pour faire avancer le projet ? »
Elle se construit sur la cohérence entre discours et actes, la fiabilité dans les engagements, et la transparence dans les intentions.
La proximité relationnelle
« Est-ce que je me sens considéré, écouté, reconnu ? »
Nous avons tous besoin de reconnaissance et cette dernière passe, avant tout, par la relation.
Et une relation, cela se travaille. Cela passe déjà par quelques impératifs :
- Identifier les intérêts de chacun
- Comprendre les contraintes spécifiques
- Reconnaitre les enjeux personnels
- Adapter son langage au profil (DISC / PCM)
Je parle d’intelligence relationnelle : cette capacité à comprendre les logiques de l’autre pour parler le langage qui mobilise.
Les erreurs classiques à éviter
Je parle d’erreurs classiques car ce sont celles que je rencontre le plus lorsque j’accompagne des managers transverses. Certaines de ces erreurs se retrouvent d’ailleurs bien au-delà des responsabilités transverses que j’adresse aujourd’hui.
Penser que la logique suffit
Un bon argument ne suffit pas à convaincre. La réalité émotionnelle, identitaire ou politique des acteurs l’emporte souvent sur la logique pure.
Se targuer d’agir pour le siège et des objectifs communs
Vouloir imposer, insister, donner des ordres déguisés (le fameux ‘’tu devrais …’’) voire menacer d’en référer plus haut créent de la résistance. Cela nourrit la méfiance et renforce l’évitement.
Vouloir être apprécié à tout prix
L’influence ne se gagne pas par la sympathie ou la fausse connivence, mais par la clarté, la constance et la valeur ajoutée. Un manager trop “agréable” peut être perçu comme flou, voire manipulateur.
Pour éviter ces erreurs, il est essentiel de développer certaines compétences. Et, rassurez-vous, c’est possible ????
Les compétences clés du manager d’influence
De tous les managers transverses performants que j’ai rencontré au cours de ces 20 dernières années, tous avaient un point commun : celui d’allier les compétences suivantes.
1. Une communication mobilisatrice
Savoir communiquer avec efficacité est une compétence bien plus complexe qu’on ne pourrait le croire. C’est un travail de chaque instant.
Bien que ce sujet me passionne, je vais me concentrer ici sur les clés pour que cette communication mobilise.
Sans revenir de manière trop détaillée sur le mode de fonctionnement de notre cerveau, il est essentiel que nous gardions toujours en tête que nos décisions sont, avant tout, émotionnelles. Attention, je ne dis pas que nous ne rationnalisons jamais, mais bien que ce sont avant tout nos émotions qui guident notre processus décisionnel.
Il nous faut donc susciter des émotions pour que ce processus s’engage chez l’interlocuteur que nous cherchons à mobiliser.
Pour ce faire, il y a des ‘’basics’’ à respecter :
- Le plus important est de savoir s’adapter à son interlocuteur. Comprendre son mode de fonctionnement, les besoins qu’il cherche à satisfaire lorsqu’il passe à l’action, ses leviers de motivation etc. Sans cela, vous risquez de passer à côté non seulement dans le fond mais également dans la forme de votre message. Le modèle DISC reste le plus simple à appréhender pour bien comprendre les différents profils.
- Bien que nous captions les informations au travers de l’ensemble de nos canaux sensoriels (la vue, l’ouïe, le toucher, le goût et l’odorat), il s’avère que la vue est le sens le plus sollicité chez l’humain. On dit que plus de 60 % du cortex est dédié au traitement visuel. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la visualisation a ce pouvoir extraordinaire de mémorisation et d’ancrage (je m’arrête là sur la visualisation car je pourrais en parler des heures ????). Où je veux en venir ? au fait que, si vous étayez vos propos d’histoires ou de métaphores, vous favorisez l’encodage mnésique de votre interlocuteur et le projetez plus facilement dans l’action. En effet, Les histoires et métaphores activent les mêmes zones cérébrales que celles qu’on utiliserait si l’on vivait l’expérience racontée.
- Quoique vous disiez, il est primordial de formuler votre message de façon positive. Je veux dire par là
- Éviter la négation qui est traitée bien plus lentement par notre cerveau et avec une charge cognitive importante car il doit d’abord imaginer l’action, puis l’inhiber. Exemple : “Ne pense pas à un éléphant rose” => notre cerveau génère d’abord l’image avant d’essayer de l’inhiber.
- Éviter les ‘bémols de langage’ comme un (petit) peu, parfois, peut-être, éventuellement etc. Même s’ils peuvent être utiles dans certains contextes, ils détruisent la valeur de votre message dans les situations où vous cherchez à convaincre. Dans ces situations, ils nuisent à la clarté de votre message et à sa crédibilité. C’est ce qu’on appelle une double opération mentale et c’est fatiguant ???? L’idéal est plutôt de formuler ce que vous souhaitez activer plutôt qu’éviter.
2. La clarté d’intention
La clarté d’intention va bien au-delà de vos propres attentes au sens livrables du terme. J’entends surtout par-là la notion de sens. Mais attention … je parle du sens pour votre interlocuteur, et non pour vous.
Rappelez-vous des premières questions que notre cerveau se pose lorsqu’on cherche à nous mobiliser : y-a-t-il un danger pour moi ? Quel intérêt ai-je à le faire ? Qu’est-ce que j’y gagne ?
Évidemment, ces questions sont souvent inconscientes mais elles sont bien là.
Pour revenir (quand même ????) sur la notion de livrables, gardez en tête que ce cerveau, à la fois si complexe mais si simple parfois, ne comprend que ce qui est clairement énoncé. Et quand je dis clairement, je parle de mots simples, de phrases courtes, d’objectifs concrets.
3. La capacité à construire des alliances
Développer sa capacité d’influence nécessite, on l’a vu plus haut, de bien comprendre comment chacun fonctionne. Mais cela nécessite également de prendre en considération l’intégralité de l’écosystème dans lequel vous intervenez.
En effet, si vous intervenez en transverse, cela signifie que vous allez devoir interagir avec des membres d’équipes au sein desquelles il y a des règles, officielles et officieuses, des jeux d’influence voire de pouvoir.
Or, l’influence ne se décrète pas, elle se tisse. Et c’est ce que vous allez devoir faire.
Il va donc vous falloir identifier les bons relais, les parties prenantes clés, et surtout, établir une coalition de soutien autour de votre projet ou de votre mission.
Pour cela, deux étapes sont essentielles :
- Cartographier les acteurs
- Qui sont les décideurs ? Les utilisateurs finaux ? Les sponsors officieux ? Les freins potentiels ?
- Utilisez une matrice d’influence croisant :
- Niveau d’impact sur le projet
- Niveau de soutien actuel (appui / passif / opposant)
- Votre objectif est alors de concentrer votre énergie relationnelle là où elle est la plus stratégique.
-
- Créer une dynamique de coopération
- Une alliance ne se crée pas par une simple réunion. Elle se nourrit :
- de reconnaissance (« j’ai besoin de toi pour… »)
- de valorisation (« ton expertise est clé sur… »)
4. La capacité à réguler les résistances individuelles dans un système déjà contraint
Le vrai défi d’un manager transverse est de demander sans imposer dans un système déjà chargé.
Parce que, dans le management transverse, on ne pilote pas une équipe, on s’adresse à des individus qui ont :
- d’autres priorités (celles de leur manager direct),
- d’autres urgences,
- et parfois… peu de raisons objectives de vous accorder du temps
C’est là que votre rôle dépasse la coordination : vous devenez un régulateur de résistances, un facilitateur d’adhésion, dans un système où le “non” est plus probable que le “oui”.
Les résistances les plus fréquentes :
- ‘’Je n’ai pas le temps’’ (traduction : priorité perçue trop basse)
- ‘’Ce n’est pas à moi de faire ça’’ (flou des rôles ou sentiment d’illégitimité)
- ‘’Mon manager ne m’a pas parlé de ça’’ (loyauté hiérarchique, peur de faire doublon ou de s’exposer)
- Silence ou absence de réponse (résistance passive souvent due à l’encombrement ou à l’absence de lien)
Ce que signifie “réguler” ici :
Réguler, ce n’est pas forcer.
C’est accueillir la résistance sans la juger, puis :
- Donner du cadre clair à votre demande
- Nommer la tension légitime (charge, priorité, flou…)
- Créer les conditions minimales d’adhésion volontaire
3 réflexes de régulation efficaces :
1. Cadrez votre demande comme un contrat clair
Qui fait quoi, pourquoi, quand, avec quel impact ?
Moins votre demande est floue, moins elle entre en conflit avec la hiérarchie directe.
Une demande claire est plus facile à évaluer et à prioriser.
2. Validez la contrainte avant d’insister
‘’Je comprends que ce n’est pas simple à intégrer dans ta charge actuelle’’
Nommer la difficulté, c’est déjà alléger la tension. Cela désactive une partie de la résistance en montrant que vous ne niez pas la réalité du terrain.
Évidemment, et j’insiste sur ce point, la forme est tout aussi importante que le fond. Si vous n’y croyez pas, ni vous ne faites pas preuve d’un minimum d’empathie, cela se sentira et … cela n’aura aucun effet.
3. Ouvrez un espace d’ajustement plutôt que de confrontation
‘’Qu’est-ce qui te permettrait de dire oui à cette demande sans mettre en péril tes autres priorités ?’’
Vous inversez ici le rapport : la personne devient co-auteure de la solution.
C’est un levier d’engagement bien plus efficace que l’insistance ou le rappel de l’importance du projet.
Je vous donne un exemple :
Une responsable financière que j’ai accompagné me partageait sa difficulté à obtenir les reportings financiers de certaines filiales dont elle avait la charge en temps et en heure.
La réponse qu’elle obtenait fréquemment d’un de ses relais financiers était la suivante :
‘’Franchement, je n’ai déjà pas le temps de remplir les reportings demandés par mon manager’’
La réponse qu’elle apportait (sans succès) : ‘’Pourtant c’est une priorité au niveau du siège, tu es tenu de le faire’’
Nous avons donc travaillé sur différents points dont l’approche régulatrice en 3 temps :
- Cadrer la demande comme un contrat clair
‘’Ce reporting mensuel va nous permettre d’anticiper les risques financiers potentiels à l’échelle du groupe. 15 minutes suffisent, et je suis disponible si besoin pour le compléter avec toi au départ’’
-
- Valider la contrainte avant d’insister
- ‘’Je vois que ça tombe à un moment où tu es déjà très sollicité, et je comprends que ça puisse être vécu comme une demande en plus’’
-
- Ouvrir un espace d’ajustement co-construit
- ‘’Qu’est-ce qui te permettrait de répondre à cette demande sans impacter le reste ?’’
- ‘’Si tu devais faire un compromis viable, il ressemblerait à quoi ?’’
-
Dans un contexte transverse, la demande isolée ne suffit pas. Il faut réguler la dynamique qu’elle génère :
- Tension avec la charge de travail
- Tension avec les consignes managériales
- Tension avec la perception de légitimité
Le rôle du manager transverse est alors d’apaiser, clarifier et co-ajuster, sans renoncer au cap.
Je dis souvent que “Influencer, ce n’est pas faire faire. C’est faire en sorte que l’autre ait envie de faire, malgré ses contraintes”
Conclusion : Le pouvoir d’influencer sans imposer
Le manager transverse est l’un des acteurs clés de la transformation moderne des entreprises. Il n’a pas d’autorité formelle… mais un pouvoir d’influence immense.
À condition d’incarner un leadership fondé sur :
- L’intelligence relationnelle
- La clarté d’intention
- La force du lien plutôt que du rang
Comme le dit Simon Sinek :
« Leadership is not about being in charge. It’s about taking care of those in your charge »
Et dans le management transverse, c’est encore plus vrai : il ne s’agit pas de diriger les autres, mais de les aider à avancer… avec vous.
Dans un prochain article, je vous partagerai le ‘’petit truc en plus’’ des managers transverses qui performent le mieux à ce poste. Ce qui les rends encore plus efficaces. Restez connectés ????

par Laëtitia Rudelle | Août 25, 2025 | Tous les articles
Je ne sais pas vous mais moi je pose mes ‘’bonnes résolutions’’ plutôt en septembre qu’en Janvier.
Je sors des vacances, je suis reposée (enfin normalement ????) et prête à attaquer la rentrée. Comme les enfants en fait ????
Alors, j’ai pensé à vous, chers managers, et j’ai décidé de vous faire une compilation de ce que je pense être les bonnes résolutions pour gagner en performance managériale.
Celles que j’applique moi-même et que je fais travailler lors de mes accompagnements.
Il n’y a pas de hiérarchie spécifique car j’estime que toutes sont essentielles. Et elles sont souvent étroitement liées les unes aux autres.
Pour chacune, je vais tâcher de vous partager les objectifs visés, les méthodes et les outils les plus utiles.
Chacune de ses résolutions ayant déjà été traitée en détail au sein du blog Hominance, vous pourrez donc vous référer aux articles dont je vous partagerai le lien dans chacune des rubriques.
Et gardez en tête que l’équipe Hominance peut vous accompagner sur chacun de ces sujets ????
1. Maîtriser ma communication
Vaste, très vaste, sujet. Et l’un de mes préférés ???? c’est d’ailleurs un de ceux sur lequel je me documente et me forme le plus.
J’ai coutume de dire, dans mes accompagnements, que la forme compte autant que le fond si ce n’est plus car c’est elle qui donne l’intention.
Et, autant vous dire, que j’en ai passé des années à travailler la forme ????
Maîtriser sa communication a tellement de bienfaits que je suis sûre que je vais en oublier ????.
Les méthodes, outils ou principes qui font aujourd’hui parties de mon quotidien :
Même si je sais que le DISC n’est pas considéré comme un outil scientifiquement validé au sens strict des critères de la psychologie moderne, cela reste, à mes yeux, un outil pédagogique incroyable pour décrire et comparer des comportements, introduire un langage commun et, surtout, apprendre à adapter sa communication à chacun de ses collaborateurs.
Évidemment, il faut en éviter ses pièges. Le plus courant étant celui de coller une étiquette à chacun en le décrétant de telle ou telle couleur. Ce qui serait faux puisque nous disposons de toutes les ressources en nous, à des dosages différents.
- La congruence de mes 3 leviers de communication
Paul Watzlawick disait ‘’on ne peut pas ne pas communiquer’’. C’est l’une des premières choses que j’ai découverte lors de mon premier coaching.
Mon manager me l’avait proposé car je devais progresser en écoute active. Pour vous la faire courte : je coupais mes interlocuteurs que j’estimais trop longs et trop laborieux dans leurs discours. J’estimais avoir compris ce qu’ils cherchaient à me dire en quelques minutes et je leur apportais une réponse. Évidemment, elle n’était pas toujours correcte puisque je n’avais pas écouté jusqu’au bout ????
Bref, mon coach m’a donc appris à me taire et à écouter.
Seulement, il restait un problème … de taille.
Tout mon visage voire mon corps manifestait une impatience grandissante. Je communiquais toujours mais différemment.
Vous pouvez imaginer qu’il y a eu encore beaucoup de travail ????
Je retrouve d’ailleurs ce trait de caractère chez mon fils cadet dont les professeurs me disent souvent : il n’a pas besoin de parler, son insolence se lit dans ses yeux ????
Bref, tout ça pour vous dire que cela fait partie de ma boîte à outils aujourd’hui : l’étude du non verbal et l’intention transmise dans le ton.
Le non verbal car, au-delà du mien que je travaille, je prête beaucoup plus attention à celui de mes interlocuteurs pour y déceler les émotions ressenties non exprimées et les non-dits. Quand j’ai un doute, je questionne en mettant quelques précautions oratoires : ‘’Dis-moi si je me trompe, mais j’ai l’impression que …’’.
Cela donne à l’autre cette liberté de partager ce qu’il ressent en tout confiance.
Toute confiance si la tonalité est la bonne. Je dis souvent : on peut tout dire, à condition d’y mettre la forme. Et le paraverbal (le débit, le volume et le ton) en fait partie.
J’adore cet extrait du film « Le Schpountz », de Marcel Pagnol où Fernandel (oui ce n’est pas tout jeune) en fait une démonstration incroyable : https://www.youtube.com/watch?v=2-WM1thoakg
- La meilleure connaissance du mode de fonctionnement de notre cerveau
Sans entrer dans le détail de tout ce que j’ai appris ces dernières années sur cette machine complexe et qui m’aide au quotidien, je vous partage ici l’essentiel.
La première chose à avoir en tête, c’est le poids des émotions dans le processus décisionnel. La recherche scientifique montre en effet que les émotions jouent un rôle incontournable dans toutes nos décisions, sans pour autant remplacer complètement le raisonnement.
Les émotions en sont le déclencheur, le filtre et parfois… le biais.
Alors, concrètement, qu’est-ce que cela signifie et en quoi cela peut vous aider au quotidien ?
Je vous le résume en 3 points :
- Vouloir convaincre uniquement par des arguments logiques est souvent inefficace
- Il faut créer un ressenti (sécurité, confiance, excitation, reconnaissance…) avant de dérouler l’argumentaire
- La séquence idéale pour engager, motiver, convaincre est donc la suivante : émotion → raison → engagement
Évidemment, quand on parle de communication, on se doit également de penser aux différents canaux à notre disposition. D’autant que dans notre monde de travail hybride, on n’a pas toujours tout le monde ‘’sous la main’’.
Je vous avoue que j’ai très longtemps lutté contre mon impatience et mon besoin de traiter le sujet qui me préoccupe dans la seconde ????
Cela m’a amené à adopter la stratégie suivante : quand je dois communiquer que ce soit en one-to-one ou à un groupe, je me pose ces 2 questions :
- Est-ce que j’attends une réponse ?
- Et, sous quel délai ?
Cela me permet de choisir le canal le plus adapté à mon message.
Cela m’a permis de ‘’catégoriser’’ les canaux tout en restant adaptable si nécessaire.
- Le téléphone
- Le SMS
- Le mail
- La visio
Enfin, j’ai envie de vous parler de transparence.
- La transparence en communication : un sujet qui fait débat.
Faut-il tout dire à ses collaborateurs ? ou faut-il, au contraire, les maintenir dans l’ignorance sur certains sujets, pour les préserver ?
Comme dans tout, il y a des avantages et des inconvénients à être transparent. Et, de mon point de vue, il n’y a pas de règle absolue. Cela dépend aussi beaucoup de votre mode de fonctionnement qui est façonné par tellement de choses que je ne vais pas toutes les lister.
Pour ma part, j’ai toujours opté pour la transparence.
Déjà, parce que c’est mon caractère. Je fonctionne comme ça déjà dans ma vie privée.
Mon objectif en faisant ça c’est d’éviter l’effet de surprise et, donc, de possibles ‘’chocs émotionnels’’. Cela me permet aussi d’impliquer mes collaborateurs dans la construction d’un plan d’action.
D’ailleurs, il y a un outil que j’utilise dans ces moments-là : les chapeaux de Bono. Cet outil est top pour mener une réflexion fondée sur l’intelligence collective !
Je vous le conseille vivement.
Pour en savoir plus :
2.Renforcer ma compréhension des motivations profondes de mes collaborateurs
Je ne sais même pas par où commencer sur ce sujet ????
Je vais déjà garder en tête que ces bonnes résolutions de la rentrée sont une compilation de très nombreux articles que j’ai déjà rédigés.
Je vais donc tâcher d’en faire une synthèse, sans trop de redondances.
Cette synthèse ayant vocation de vous aider à enrichir votre plan de développement personnel destiné à renforcer vos compétences managériales.
Pour rappel, la motivation est l’ensemble des forces internes et externes qui orientent, déclenchent et maintiennent nos comportements vers un objectif.
L’envie est donc suivie de l’action. Si je n’agis pas alors je n’étais pas réellement motivée.
Il y a deux sources de motivation et c’est important de le garder en tête car, en tant que manager, vous n’avez de pouvoir direct que sur l’une d’entre elle et ce n’est pas la plus pérenne ni la plus puissante :
- La motivation intrinsèque : elle vient de l’intérieur, alimentée par le plaisir, l’intérêt ou le sens que l’on trouve à la tâche (ex. curiosité, accomplissement personnel, apprentissage). Elle est très fortement impactée par la confiance en soi.
- La motivation extrinsèque : elle est stimulée par des facteurs extérieurs, souvent matériels ou sociaux (ex. prime, reconnaissance, promotion, évitement d’une sanction). Bref, celle sur laquelle la majorité des managers agissent aujourd’hui.
La motivation durable s’appuie surtout sur l’intrinsèque, l’extrinsèque étant utile mais plus fragile dans le temps.
Je fais une petite parenthèse sur un podcast que j’adore et l’épisode dédié à la motivation. Je vous engage vivement à l’écouter. Pour ma part, il m’a énormément éclairé : L’envers du business – Pourquoi promettre des récompenses tue la motivation.
Reprenons le fil … en nous concentrant sur la motivation intrinsèque. Car, certes, elle vient ‘’de l’intérieur’’ mais, pour la déclencher, encore faut-il qu’il y ait du sens à ce que fait votre collaborateur. Et, c’est là que vous avez un rôle à jouer.
Le sens s’appuie sur le fameux ‘’pourquoi’’ je fais ça. Et, plus précisément sur ce que je cherche à nourrir chez moi. Ce que j’appelle basiquement en formation le QiPM : Quel intérêt pour moi ? J’y gagne quoi concrètement ?
Et je ne parle pas de gains matériels ici. Je parle de ce dont j’ai besoin pour me sentir bien, pour être fier, pour contribuer à quelque chose qui est important pour moi, pour être reconnu.
Pour ma part, j’ai quelques ‘’rituels’’ pour travailler la motivation de mes collaborateurs :
- Renforcer ma connaissance de leurs modes de fonctionnement sur la base de
- Leur profil DISC et Forces Motrices
- Leurs drivers
- Leurs croyances limitantes
- Déterminer leur facteur principal de motivation en m’appuyant sur la théorie de l’autodétermination de Deci & Ryan :
- Autonomie : avoir un certain contrôle sur la manière d’atteindre ses objectifs.
- Compétence : se sentir capable et progresser.
- Lien social : se sentir connecté et reconnu par les autres.
- Éviter tous les pièges auxquels un manager est confronté
- Donner des objectifs flous ou irréalistes
- Oublier de reconnaître et valoriser les succès
- Vouloir tout contrôler en laissant peu de latitude
- Ignorer la charge de travail
Je ne reviens pas sur les précédents points déjà abordés comme la communication ou le sens.
Pour en savoir plus :
3. Piloter la performance individuelle et collective de mon service
Vous savez que je rencontre encore des managers qui me disent ‘’ne pas vouloir jouer aux flics’’ et qui se refusent à mettre en place un suivi régulier de la performance de leurs collaborateurs ?
Pire, je vois encore des commerciaux sans objectifs. Vous me direz, c’est toujours mieux que des objectifs abracadabrants (ou en écrivant ce mot, je me dis que les jeunes générations qui me liront vont clairement comprendre que j’ai plus de 50 ans ????)
Revenons sur le cœur du sujet (j’ai une grosse tendance à me disperser ????).
Piloter la performance individuelle et collective, et j’insiste sur ces 2 facettes, a de nombreux avantages :
- Gérer l’effort pour une performance durable.
La recherche de performance ne doit pas devenir un épuisant « marathon sans ligne d’arrivée ». Il s’agit de gérer intelligemment votre énergie et celle de votre équipe pour assurer une performance sur le long terme.
- Adopter une vision de la performance continue
La performance est un processus continu qui nécessite un engagement constant, une remise en question régulière et des ajustements permanents. Encore plus dans le monde au sein duquel nous vivons et qui ne cesse d’évoluer.
Bien entendu, un pilotage régulier et ritualisé vous permet d’arriver en fin d’année avec la certitude que tout a été fait pour être fier du résultat. Que le budget ait été atteint ou non. Ce que vous pourrez expliquer puisque vous avez une analyse fine de ce qui a été mis en place.
Je n’aborderai pas dans cette séquence la notion d’objectifs bien conçus, nous verrons cela plus tard.
Je vais rester concentrée sur la notion de pilotage et, plus précisément les clés pour faire que ce dernier soit le plus efficace possible.
Il y a 4 piliers qui contribuent à la performance, et je ne parle pas uniquement de la performance commerciale :
- Les compétences métiers
- Les compétences relationnelles
- L’organisation
- La motivation
Ce qui signifie que, quand la performance est absente, un ou plusieurs de ces piliers est défaillant et il s’agit de trouver lequel.
Un peu comme le ferait un médecin face à vos symptômes. Il vous ausculte, vous pose des questions et compare vos constantes à la norme.
Face à un manque de performance, vous allez donc, vous aussi, réaliser un diagnostic sur ces 4 piliers pour comprendre ce qui manque à votre collaborateur pour y arriver. Ce diagnostic passe par de l’observation en situation et du questionnement.
Et, c’est sur cette base, que vous pourrez alors faire un plan d’actions personnalisé. Quand je parle de plan d’actions j’entends : des actions concrètes, des indicateurs de suivi et un timing.
Je le souligne car ce n’est pas toujours ce que je retrouve quand on me présente des plans d’actions …
Vous ne l’avez jamais fait encore ? Il n’est jamais trop tard et l’année n’est pas finie ????
Pour en savoir plus :
4. Favoriser l’apprentissage continu et la montée en compétences de l’équipe
Cette résolution s’inscrit dans la continuité de la précédente. Gérer la sous-performance en mettant en place un plan d’actions directement lié à un diagnostic complet on sait faire. En revanche, établir un plan de montée en compétences pour les plus performants de l’équipe, c’est moins fréquent.
Ce que j’entends souvent de la bouche des managers à qui je pose la question : ‘’eux ça roule, ils sont bons’’.
Oui, ils sont bons aujourd’hui. Mais demain ?
Je prends souvent l’exemple de la période Covid-19 et, plus précisément, du confinement. J’accompagnais à ce moment-là une grosse équipe de commerciaux et leurs managers. Un environnement industriel où le contact est facile et le relationnel encore très important pour faire du business.
Comme dans toute équipe commerciale, il y avait des très bons : secteur connu et maîtrisé, clients fidèles, objectifs atteints.
Ceux-là étaient laissés très autonomes sans vraiment d’accompagnement de la part de leur manager.
Puis, du jour au lendemain, nous voilà tous confinés. Mais, le business, lui, doit continuer, à distance. Les commerciaux doivent prospecter par téléphone ou visio. Et, là, panique à bord. Les compétences à mobiliser ne sont plus les mêmes. Il faut susciter l’intérêt différemment et dans un temps plus court. Et, une partie des meilleurs s’effondrent, en silence.
Heureusement la société a réagi vite et nous avons mis en place des formations à distance sur le sujet. Mais ce n’est pas toujours le cas.
Ce que je veux dire au travers de cette histoire c’est que les compétences d’aujourd’hui peuvent être obsolètes demain. Et que même les meilleurs ont toujours des choses à apprendre.
Alors, pensez à identifier les besoins de montée en compétences pour chacun de vos collaborateurs et mettez en place un plan de formation individuel et collectif.
Pour ma part, chaque année, je prends du temps pour me former. Sur de nouveaux sujets ou pour en renforcer certains. J’en ressors grandie, avec de nouvelles cordes à mon arc que je partage chaque jour avec mes clients.
5. Préparer mes entretiens annuels
Nous sommes donc dans les bonnes résolutions de la rentrée ce qui signifie que les entretiens annuels approchent.
Et, ces entretiens se préparent normalement toute l’année. Car ils se nourrissent de tous les entretiens individuels qui ont été menés sur les 12 derniers mois.
Vous ne pouvez pas imaginer la tension que cela suscite chez bon nombre de managers que j’accompagne. Ils voient arriver l’échéance avec anxiété en se demandant comment réaliser tous ces entretiens en respectant l’échéance donnée par leur service RH. Et je les comprends j’ai longtemps vécu la même chose.
Je ne vous dirais pas que si vous avez régulièrement fait des entretiens individuels, quels qu’ils soient et on y reviendra, et que vous disposez des comptes-rendus, vous allez passer moins de temps à préparer.
Ce serait faux car, même avec toutes ces informations, cela prend du temps. Entre 1h et 2h par entretien.
Mais, sans, vous allez carrément galérer ????
Pour autant, rassurez-vous, vous aurez les clés pour mieux faire l’année prochaine ????
L’entretien annuel s’articule autour des deux sujets suivants, dans l’ordre :
- Le bilan de l’année passée
- La fixation des objectifs pour celle à venir
Je dis souvent que le bilan représente les fondations de la maison que vous allez ensuite construire : si ces dernières sont mal réalisées alors les objectifs seront difficiles à poser.
Je ne vais pas détailler chacune des étapes de cet entretien car vous les retrouverez dans les articles dédiés que je vous propose à la fin de cette rubrique.
En revanche, je vais vous partager ce que j’estime être la pierre angulaire dans ce type d’entretien et qui assure, ou non, sa réussite.
Un être humain ne peut s’approprier des objectifs que s’il a contribué à les construire
Que ces objectifs soient quantitatifs ou qualitatifs c’est-à-dire un changement de comportement.
Sans respecter cette règle fondamentale, vous n’aurez pas de pérennité dans les efforts engagés (quand ils sont engagés …) par votre collaborateur. Et cela donnera ce que j’entends souvent : ‘’il n’a rien compris ! ‘’ ; ‘’ça fait 15 fois que je lui répète la même chose’’ ; ‘’il y met de la mauvaise volonté’’ ; ‘’il ne fait pas d’efforts’’ etc.
Ce principe repose sur plusieurs fondements psychologiques et neuroscientifiques que je vais rapidement vous rappeler :
- Le biais d’engagement et de cohérence
Principe : lorsqu’une personne s’engage volontairement dans une décision, elle tend à agir de façon cohérente avec cet engagement pour préserver son image de soi.
Conséquence : si l’objectif est coconstruit, la personne se sent impliquée, donc plus encline à le poursuivre et à fournir des efforts pour l’atteindre.
- Le sentiment d’autodétermination (Théorie de Deci & Ryan citée plus haut)
Principe : la motivation durable repose sur trois besoins psychologiques fondamentaux : autonomie, compétence, et relation.
Conséquence : participer à l’élaboration de ses objectifs renforce le sentiment d’autonomie, ce qui stimule la motivation intrinsèque.
- La théorie de l’appropriation cognitive
Principe : on valorise davantage ce que l’on a contribué à créer (ce qu’on appelle l’effet IKEA).
Conséquence : coconstruire un objectif le rend plus significatif et augmente la perception de sa valeur.
- La réduction de la dissonance cognitive (Festinger)
Principe : si l’on choisit et formule soi-même un objectif, il est plus coûteux psychologiquement de l’abandonner, car cela contredirait ses propres décisions.
Conséquence : l’engagement personnel agit comme un verrou psychologique contre l’abandon.
- Le besoin de sens et de finalité (Viktor Frankl)
Principe : un objectif doit avoir une signification perçue pour être motivant.
Conséquence : la co-construction permet d’aligner l’objectif avec ses valeurs, ses priorités et sa vision, renforçant ainsi le sens donné à l’action.
Pour résumé, on ne s’approprie vraiment un objectif ou un changement que si
- on a participé à sa définition
- il répond à un sens personnel
- on y a investi du temps ou des idées
Pour information, cela est également valable dans la vie privée et, notamment avec vos enfants ????
Pour en savoir plus :
6. Renforcer mon questionnement
Je n’ai sciemment pas glissé ce sujet dans la rubrique ‘’Maîtriser ma communication’’ car cette compétence vitale mérite un focus plus important.
D’ailleurs, elle n’est pas valable que pour les managers. On gagnerait tous à renforcer notre capacité à questionner utile.
Déjà, cela nous éviterait de tomber dans les nombreux pièges de la communication qui biaisent notre compréhension de l’autre et de ses messages.
La plupart des erreurs commises en communication sont dues aux biais cognitifs, ces déviations de pensée qui nous conduisent à des erreurs de jugement et à des interprétations illogiques ou irrationnelles d’une situation donnée. Il y en a plus de 200 répertoriés donc autant vous dire que notre cerveau a de quoi faire ????.
Au-delà d’écouter attentivement vos collaborateurs, il est donc important de bien les comprendre. Et, le questionnement exerce un effet puissant pour
- Favoriser une prise de conscience et repousser les réflexes automatiques
- Réduire les biais cognitifs de manière significative (30 % et plus selon les études réalisées sur le sujet)
- Améliorer la précision de la mémoire et la qualité de la compréhension.
À chaque typologie de questions correspond un objectif précis et c’est un point sur lequel je passe toujours beaucoup de temps lors de mes accompagnements : les questions utiles et l’entraînement pour bien les manier.
Pour en savoir plus :
7. Renforcer mes rituels managériaux
Vous allez vraiment penser que j’exagère mais c’est la réalité de ce que je vois sur le terrain depuis 10 ans que j’exerce en tant que formatrice et coach : moins d’un tiers des managers ont des rituels managériaux définis et efficaces.
J’entends par là
Des entretiens individuels, pour l’ensemble des membres de leur équipe, qui sont réguliers, planifiés et qui ont chacun leur objectif :
- Faire un suivi de l’activité (en général, c’est fait au sein des équipes commerciales et des équipes projet car c’est dans leur ADN)
- Réaliser un feedback de développement à la suite d’une observation (d’un rendez-vous ou d’un entretien client pour un commercial par exemple)
- Féliciter sur une réussite (et oui cela nécessite un entretien formel pour que cela ait vraiment du poids)
- Réfléchir sur les correctifs à mettre en œuvre à la suite d’un échec
- Recadrer quand c’est nécessaire (sans attendre que la sortie de cadre soit incontrôlable)
Des moments collectifs officiels, réguliers et cadrés pour :
- Impliquer les collaborateurs dans une prise de décisionfaire
- Réfléchir sur la stratégie à adopter face à tel ou tel obstacles à la performance
- Réfléchir sur les correctifs à mettre en œuvre à la suite d’un échec collectif (le fameux post-mortem des développeurs)
Alors, oui, cela prend du temps, encore plus lorsqu’on manage un grand nombre de collaborateurs. Mais, c’est essentiel car cela fait partie du métier de manager.
D’où ma ‘’bataille’’ contre les managers producteurs qui arbitre souvent en faveur de la production (donc en faveur des résultats visibles soyons clairs) au détriment du management.
C’est entendable mais malheureux. Car, lorsque les Hommes partent (et 60% quittent leur entreprise à cause de leur manager), il n’y a plus personne pour faire le chiffre …
Pour en savoir plus :
8. Continuer à déléguer avec anticipation et méthode
Au moment où j’écris cet article (en plein mois d’août, un matin tôt avant que la canicule me rattrape) c’est une des réflexions que je mène activement pour préparer ma rentrée.
Hominance a passé un cap cette année et, malgré une équipe de consultants incroyables, je sais que je ne tiendrais pas longtemps en assumant seule autant de choses.
Alors, j’écris (enfin je tape sur mon clavier)
#. Le Quoi car il ne s’agit pas de déléguer n’importe quoi, ni pour moi ni pour ceux à qui je vais faire confiance.
Les tâches voire, dans l’idéal, les missions déléguées se doivent
- D’être suffisamment intéressantes pour celui qui les reçoit afin de favoriser son engagement et d’activer sa créativité (car, qui sait, peut-être le fera-t-il différemment et mieux que moi ????). Dans la mesure du possible, j’évite donc de confier un bric à broc de petites tâches sans queue ni tête les unes avec les autres.
-
- De me dégager suffisamment de bande passante (temporelle et psychologique) pour me concentrer sur d’autres choses ou, pourquoi pas, prendre un peu de repos ????.
#. Le Qui pour associer à la bonne personne la bonne mission. Que ce soit au sein de l’équipe ou à un prestataire extérieur, il s’agit de faire coïncider mission et talent.
On s’entend, même si une délégation s’accompagne, l’idéal est de déléguer à quelqu’un qui sera rapidement autonome sur le sujet.
Pour un collaborateur interne, le plus ‘’rapide’’ est de se pencher sur son profil DISC. Ses couleurs dominantes associées à ses forces motrices vous donneront énormément d’informations. Sans compter qu’une discussion sur le sujet pour creuser sa motivation s’impose.
Pour un prestataire extérieur, j’aurais envie de vous dire le feeling car c’est mon mode de fonctionnement ???? mais il y a aussi les avis Google et LKD.
#. Vient ensuite le Comment et il est primordial. Prendre le temps d’accompagner la délégation est la garantie première de son succès.
Et cela commence par une réunion de lancement pour
Je ne vais pas revenir sur l’importance de donner du sens et l’influence que cela a sur la motivation et l’engagement. Sinon, vous allez dire que je radote ????
En revanche, je vais vous rappeler qu’il est essentiel d’expliquer à votre collaborateur pourquoi vous lui confiez cette mission, à lui et à personne d’autre. Cela vous permet de lui rappeler ses grandes qualités, de lui démontrer la confiance que vous avez à son égard et, tout simplement, de le booster.
Et là, je vais faire le lien avec le feedback positif. Car c’est de cela qu’il s’agit lorsque vous mettez en lumières les compétences de votre collaborateur qui vous ont amenées à le choisir lui.
En faisant çà, vous stimulez sa production de dopamine ce qui booste alors son énergie et sa motivation. Avant même de commencer à travailler sur le sujet !
Cela serait dommage de s’en priver ????
Quels sont les objectifs de cette délégation ? Ces livrables ?
Sous quel timing ?
Quels sont les indicateurs qui vous permettront de déterminer si les objectifs sont atteints ? Comment vont-ils être suivis ? À quel rythme ?
Il ne s’agit pas là de lui dire comment faire mais de lui partager vos attentes. Je souligne ce point car je rencontre encore beaucoup de managers contrôlants qui attendent que leur collaborateur fasse comme eux. Or, la délégation, c’est aussi faire grandir et cela passe par l’autonomie.
- Transmettre les ressources nécessaires
Le pire que j’ai entendu lors d’un acte de délégation : ‘’débrouille-toi en interne pour trouver ce dont tu auras besoin’’.
Alors, certes, avec certains profils cela peut fonctionner mais ce n’est pas l’idéal en termes d’accompagnement.
Votre rôle est de faciliter la délégation en donnant les informations, les moyens et les contacts nécessaires à son bon déroulement.
Pensez bien, au cours de cette réunion de lancement, à interroger votre collaborateur sur sa vision des choses, les obstacles auxquels il pense être confrontés, les besoins qu’il aurait pour mener à bien cette mission et que vous n’avez pas abordés.
Attention, ce n’est pas pour autant que tout est sur les rails et que vous allez pouvoir vous la couler douce.
Car, l’accompagnement se poursuit et il se planifie.
En fin de réunion, planifiez ensemble les points d’étapes (un conseil : envoyez les invitations de suite avant d’être happé par votre quotidien) et rappelez votre disponibilité en cas de besoin.
La dernière étape d’une délégation réussie est celle que je ne vois quasiment jamais en entreprise : le débriefing officiel (c’est-à-dire un entretien dédié).
La mission s’achève et il s’agit d’en valoriser les résultats et d’en tirer les apprentissages.
Cette mission devient-elle définitive ou pas ? et sous quelles conditions si c’est le cas ?
Alors oui déléguer cela prend du temps mais il faut se dire que c’est un investissement sur le temps futur gagné.
Pour en savoir plus :
9. Renforcer ma capacité à gérer les tensions et désaccords
Vous vous demandez peut-être pourquoi ce point fait partie de mes résolutions de la rentrée et, donc, pourquoi je vous le propose.
Il y a 2 raisons à çà.
La première est que, ne nous mentons pas, personne n’aime gérer les tensions. Je vous rappelle que l’émotion que cherche sans cesse à reproduire notre cerveau est la joie. Et je vous garantis que les neurotransmetteurs de la joie ne s’activent absolument pas dans ces situations de tensions.
La seconde c’est que le dernier trimestre est généralement une source de fatigue importante. C’est la dernière ligne droite pour atteindre les objectifs, le froid pointe le bout de son nez (c’est un peu moins vrai avec le dérèglement climatique mais bon), les nuits sont plus courtes donc on souffre d’un manque de lumière. Bref, ce n’est quand même pas le pied. Et, quand on est fatigué, notre organisme alloue le peu d’énergie dont on dispose à nos fonctions vitales. Ce qui est rassurant entre nous soit dit. Ce qui signifie qu’il nous est bien plus difficile de nous contenir quand quelque chose (ou quelqu’un) nous titille. Pour la faire courte : on dégoupille plus vite.
Et, que vous deveniez agressif, que vous décidiez de fuir voire de laisser couler, aucune de ces attitudes n’est pas bonne face aux conflits, aussi minimes soient-ils.
Revoir quelques techniques recadrage bienveillant, reformulation neutre ou recherche de solutions gagnant-gagnant me semble donc tout à fait approprié pendant que nous sommes encore au top de notre forme.
J’ai énormément écrit sur le sujet ces dernières années, que ce soit sur le blog d’Hominance ou sur mon profil LinkedIn. Je ne vais pas revenir sur tout en détail. Je vous propose plutôt de vous guider vers quelques-unes des techniques puissantes pour gérer ces situations :
- Les méthodes DESC (Décrire – Exprimer – Suggérer – Conclure) et OSBD (Observation – Sentiment – Besoin – Demande) pour exprimer un exprimer un ressenti et un besoin et pour défendre ses droits tout en respectant l’autre.
- Les techniques de recadrage, de perception, de langage ou d’intention pour repositionner le problème sous un angle constructif.
- La technique de dissonance cognitive pour contourner des croyances fortes
- Le recadrage interne avec la recherche de l’intention positive de votre interlocuteur
- La reformulation émotionnelle pour accueillir l’émotion avant d’apporter une réponse plus rationnelle
- L’effet de cadrage pour présenter une difficulté sous l’angle d’une opportunité
Il y en a plein d’autres encore que vous pourrez découvrir au gré de mes publications LinkedIn, Instagram et Youtube.
Mon conseil ultime : prenez un temps pour respirer avant de réagir.
Pour en savoir plus :
10. Évaluer et ajuster mes propres pratiques managériales
Vous avez compris l’importance des feedbacks sur vos collaborateurs mais qu’en est-il de vous ? Des feedbacks sur vos propres pratiques managériales ?
Et qui de mieux que vos collaborateurs, qui le vivent au quotidien, peuvent vous en donner ?
C’est quelque chose que j’ai instauré très vite lorsque je suis devenue manager : un feedback 360°.
Évidemment, je ne le regrette absolument pas mais je peux vous dire que sur les premières années cela pouvait piquer ???? il faut être prêt à tout recevoir et, parfois, sans les formes. Le mieux est quand même d’être accompagné pour le lire, l’analyser et en tirer des actions concrètes.
Et, aujourd’hui, je le propose dans tous les parcours de formation management Hominance. Nous le décortiquons ensemble pour mettre en lumière les points forts et les zones de progrès puis pour ajuster les méthodes.
Parfois, certains outils digitaux utilisés pour les entretiens annuels le proposent. Je pense notamment à Workday ou Elevo que certains de mes clients utilisent. Cela reste du déclaratif libre mais c’est déjà très utile.
11. Cultiver la sécurité psychologique de mes collaborateurs
C’est un sujet dont j’entends de plus en plus parler que ce soit dans la presse, sur les réseaux ou au sein de certaines entreprises que j’accompagne. Il s’intègre pleinement à la notion de Qualité de Vie au Travail.
Pour moi, cela signifie
- Créer un environnement où chacun se sent libre d’exprimer ses idées, ses doutes ou ses erreurs sans crainte de jugement ou de sanction
-
- Favoriser l’écoute active, la bienveillance et le respect mutuel pour encourager la prise d’initiative, la collaboration et l’innovation
-
- Mettre en place des rituels qui accordent une place aux émotions de chacun pour mieux comprendre l’état d’esprit collectif, prévenir les malentendus ou les non-dits et nourrir un climat de confiance au sein de l’équipe.
Le premier point parle du fameux droit à l’erreur et, pour moi, c’est le pilier principal de la sécurité psychologique.
Ce qui est étonnant c’est de voir comme il a encore du mal à s’inscrire dans notre ADN. Je vous partage un exemple marquant. J’accompagne les managers d’un grand groupe français avec un programme de formation qui se déploie sur plusieurs mois. À l’issue de ce parcours, les stagiaires présentent devant le COMEX du groupe un travail de réflexion autour d’un sujet qui leur a été remis en début de formation. Ce dernier porte toujours sur une thématique importante pour le groupe. Il leur est alors demandé de d’apporter leur regard de manager sur le sujet pour le déployer et le faire vivre au sein de leurs équipes.
La notion du droit à l’erreur revient fréquemment dans les rendus. La question du Président du groupe également : ‘’pensez-vous que vous disposez de ce droit à l’erreur dans votre quotidien au sein de vos différentes entités ?’’
Lui-même étant un fervent supporter de cette notion, on pourrait penser qu’en partant d’aussi haut, elle se soit diffusée au sein de chacune des ramifications du groupe.
Il est très rare d’obtenir un ‘’oui’’ à cette question. Et, en 3 ans, j’ai déjà formé plus de 200 managers, ce qui commence à faire un échantillon représentatif.
Parce qu’en France, le droit à l’erreur n’est pas dans notre ADN :
- A l’école, l’accent est mis sur la faute et la note sanction plutôt que sur la progression.
- Dans nos entreprises, la performance est souvent jugée à court terme. C’est la culture du résultat immédiat qui prime.
- Socialement, nous avons une faible tolérance à l’échec : l’erreur est souvent associée à l’incompétence, et non à un processus normal d’apprentissage.
On comprend alors aisément que cela pousse nos collaborateurs à éviter de prendre des risques, à dissimuler leurs erreurs ou à rester dans leur zone de confort.
Et, c’est notre responsabilité de manager de changer ça.
Pour commencer (dès la rentrée ????) à l’instaurer concrètement, je vous propose quelques pistes :
- Dédramatiser l’erreur : en parler ouvertement lors des réunions, partager ses propres erreurs en tant que manager pour montrer l’exemple. D’autant que nous ne sommes pas des robots donc nous en faisons régulièrement (et même ceux d’entre vous qui êtes guidés par un ‘’Sois parfait’’ ???? Les partager vous rendra plus humains donc plus accessible pour échanger sur le sujet.
-
- Différencier erreur et négligence : une erreur sincère dans un contexte d’apprentissage n’est pas une faute grave. C’est quand elle devient répétitive et consciente que cela devient une faute.
-
- Mettre en place des débriefings constructifs : organiser des réunions dédiées pour analyser ce qui s’est passé, ce qui a été appris, et comment vous pourrez vous améliorer la prochaine fois. C’est ce que font très bien les développeurs avec leurs réunions post-mortem.
-
- Valoriser les tentatives audacieuses : récompenser la prise d’initiative même si elle ne mène pas au succès. C’est ce qu’on appelle la technique des petits pas. Je vous rappelle, pour ceux qui ont des enfants, que vous n’avez pas cloué ces derniers au pilori lorsqu’ils sont tombés après avoir tenté leurs premiers pas. Eh bien c’est pareil !
Je ne reviendrais pas sur le 2ème point, largement traité au sein de cet article.
En revanche, je souhaite développer un peu le 3ème. Le sujet des émotions en entreprise. Vaste débat, de plus en plus abordé.
J’ai énormément écrit sur le sujet des émotions et de leur place dans notre quotidien, dans notre vie professionnelle comme dans notre vie personnelle. La raison première est que c’est un point sur lequel j’ai du beaucoup travailler. Et sur lequel je travaillerai jusqu’à la fin de ma vie je crois ????
J’ai longtemps vécu un paradoxe avec mes émotions : grande difficulté à les canaliser tout en étant incapable de les nommer et de les détecter. Bien enfouie, elles revenaient parfois à la surface sans que je ne les maîtrise et sans être capable d’expliquer ce qui se passait pour moi à ce moment-là.
Bref, tout ça pour dire que ce sujet me passionne. Mais revenons à nos moutons : accorder une place aux émotions au sein de votre service pour anticiper les débordements qu’ils soient passifs ou actifs.
On a tous compris aujourd’hui que nos émotions ne restent pas à la porte de l’entreprise lorsque nous arrivons le matin. C’est déjà un progrès.
Ce que nous savons aussi, grâce aux neurosciences, c’est qu’elles influencent directement la qualité de nos décisions. Et que, quand elles ne sont pas exprimées, elles peuvent se transformer en tensions latentes, en comportements défensifs ou en conflits ouverts.
Alors je comprends quand certains managers me disent qu’ils ne sont pas psy. Ils ont raison. La RH non plus même si elle est clairement mieux formée sur le sujet que la plupart des managers.
Mais, entre être psy et apprendre à être à l’écoute des ressentis de ses collaborateurs pour mieux les accompagner, il y a une différence. Et une grande.
Je vous propose donc quelques pistes pour intégrer ce levier de performance relationnelle dans vos pratiques managériales :
- Instaurer des rituels émotionnels courts : une météo émotionnelle en début de réunion, un tour de table sur “comment je me sens” avant un point important
-
- Pratiquer l’écoute active : accueillir le ressenti sans jugement ni précipitation au lieu de chercher une solution rapide
-
- Nommer ce qui se passe pour chacun dans les moments de tensions : mettre des mots simples sur les tensions ou ambiances ressenties désamorce les malentendus.
Et le saint-graal : vous former, vous et vos collaborateurs, à l’intelligence émotionnelle ????
Pour en savoir plus :
12. Prendre soin de ma propre énergie et de ma clarté mentale
J’ai envie de finir ces résolutions par un sujet sur lequel je porte de l’attention aujourd’hui. La crise de la 50aine ????
J’ai fait 2 burn out au cours de ma carrière. Le 1er était costaud et m’a vraiment laissé sur le carreau plusieurs mois. Le 2ème, je l’ai détecté à ses prémices ce qui m’a permis de prendre les bonnes décisions rapidement. Enfin, soyons honnête, c’est mon médecin qui m’a imposé les bonnes décisions et là, je n’ai pas joué ma rebelle ????
Certains des professionnels qui m’accompagnent me les justifient par mon TDAH ou par ma biochimie. Probablement une des causes.
Mais, je sais aussi que je suis passionnée par mon travail. Et, quand je suis lancée, je ne sais pas m’arrêter. C’est une vigilance que je dois avoir à chaque instant.
Parce que, quand on est épuisé physiquement et/ou psychologiquement, on transmet cette fatigue à son équipe. Et cela impacte la performance de tous.
Comme je vous l’ai déjà dit, on connaît tous l’impact qu’a la fin d’année sur notre énergie. Or, la qualité de nos décisions dépend directement de ce niveau d’énergie et de concentration.
Vous rentrez de vacances, profitez-en pour vous ritualiser des moments de récupération (micro-pauses, marche, respiration), clarifier vos priorités et mettre des limites aux sollicitations hors horaires.
C’est en prenant soin de vous que vous pourrez prendre soin des autres. De vos proches comme de vos collaborateurs.
Conclusion
Il est fort probable que certaines de ces résolutions fassent déjà parties de votre quotidien de manager. Et peut-être que vous en avez identifié d’autres comme axes de développement. Dans ce cas, priorisez-les pour éviter de mettre en place plusieurs changements majeurs simultanément car cela serait l’échec assuré.
Laissez-moi vous expliquer pourquoi :
- Notre cerveau et, plus exactement notre mémoire de travail, ne peut traiter qu’un nombre limité d’éléments à la fois. Plus on surcharge notre cortex préfrontal, le responsable de la planification et du contrôle, moins on sera efficace. C’est un peu comme vouloir ouvrir 10 onglets lourds sur un ordinateur ancien : tout rame.
-
- Nos ressources (temps, énergie mentale, attention) sont limitées. Les diluer sur plusieurs fronts affaiblit l’impact sur chacun. Une étude menée par McKinsey en 2011 montre que les entreprises concentrant leurs efforts sur 2 à 3 priorités atteignent jusqu’à 70 % de réussite dans leurs transformations, contre moins de 30 % lorsqu’elles en poursuivent plus de 5 simultanément. Et une entreprise a des ressources. Plus que vous n’en avez, à vous tout seul.
-
- Le cerveau humain tend à préserver l’existant guidé par son principe d’homéostasie et le biais du statu quo. De ce fait, introduire plusieurs changements à la fois augmente sa résistance car chaque nouveauté active la vigilance et le stress.
-
- Il existe un effet cumulatif des micro-échecs qui s’activent quand plusieurs changements échouent ou stagnent, l’impression générale est celle d’un échec global. La conséquence est immédiate : la motivation est entamée et le scepticisme pour les initiatives futures enclenché. À contrario, enchaîner de petites victoires renforce la dynamique positive.
-
- Enfin, un changement réussi nécessite apprentissage, appropriation et intégration dans les routines de notre cerveau automatique. Or, si plusieurs changements sont lancés en même temps, aucun n’a le temps de devenir un automatisme avant l’arrivée du suivant.
‘’Changer, c’est comme gravir une montagne : si on part avec trois sacs pleins en même temps, on s’épuise et on abandonne. Avancez sac par sac : c’est plus rapide, plus sûr et plus motivant”
Si vous souhaitez être accompagné sur l’un ou plusieurs de ces sujets, contactez-nous.
Et, suivez régulièrement mes publications sur LinkedIn, Instagram et Youtube pour retrouver plusieurs fois par semaine de nouveaux outils et de nombreux conseils sur l’intelligence relationnelle.

par Laëtitia Rudelle | Août 25, 2025 | Tous les articles, Performance relationnelle
S’ils étaient réticents hier, les chefs d’entreprise ont désormais bien compris l’intérêt de l’intelligence relationnelle et émotionnelle dans l’entreprise. Devenue un enjeu majeur de performance commerciale, l’intelligence relationnelle représente un bouquet de compétences aujourd’hui prisées par les recruteurs et les cabinets de RH. C’est également un propulseur professionnel de choix pour les salariés qui souhaitent se donner les moyens d’évoluer rapidement.
Si certains profils ont développé très tôt des qualités humaines et sont naturellement doués pour l’écoute et la communication inter-personnelle, d’autres, qui n’ont pas forcément eu l’opportunité d’appréhender ces capacités dans leur jeune âge, ont besoin de travailler davantage leur intelligence émotionnelle.
La bonne nouvelle, c’est que des formations existent ! Elles proposent des parcours et des outils spécifiques qui feront de vous une personne « augmentée » !
Ces formations dédiées vous apprennent des techniques et des stratégies de développement de vos compétences relationnelles, telles que la communication efficace, la résolution de conflit, la gestion des émotions et la construction de relations de qualité.
Alors pourquoi se priver d’un parcours de formation qui peut améliorer sensiblement votre vie professionnelle et personnelle ?
Voici un tour d’horizon des bénéfices que vous pourrez retirer d’une formation en intelligence relationnelle.
Accédez plus facilement à l’emploi
Lorsque nous avons abordé les »6 bonnes raisons de développer l’intelligence relationnelle‘‘, nous avons pu remarquer que cultiver l’intelligence relationnelle et émotionnelle peut faire pencher la balance en votre faveur lors d’une candidature ou d’un entretien d’embauche.
Et les statistiques l’attestent : elles montrent qu’à compétences techniques équivalentes, une candidature mettant en avant les soft skills du candidat sera préférablement sélectionnée.
Si votre CV (ou votre lettre de motivation) fait mention de compétences douces, que vous savez les illustrer en entretien et qu’en plus, vous indiquez avoir suivi une formation pour en développer de nouvelles, alors la short-list est pour vous !
Boostez votre carrière professionnelle
En suivant ce type de formation, vous pourrez considérablement nourrir votre confiance en vous et vous sentir globalement plus à l’aise dans vos relations sociales et professionnelles. En améliorant votre communication inter-personnelle, les échanges avec vos collègues et vos managers s’en trouveront enrichis sur la durée.
En tant que nouvelle recrue, votre intégration ne peut qu’en être facilitée. Si vous avez un peu plus de bouteille, l’accession à un poste convoité sera plus aisée et plus rapide.
L’aisance relationnelle contribue indéniablement à booster votre carrière !
Faites évoluer votre management
Se former à l’intelligence relationnelle, c’est développer des comportements et compétences supplémentaires pour offrir une écoute de meilleure qualité à ses collaborateurs, et permettre ainsi de résoudre plus efficacement des problématiques liées à des situations tendues ou des relations conflictuelles.
Développer vos compétences relationnelles est essentiel pour augmenter vos performances professionnelles : en effet, elles influencent directement votre capacité à convaincre, fédérer, gérer des projets, manager une équipe, etc.
Une formation en intelligence émotionnelle et relationnelle vous permet, entre autres, de :
- créer une relation de confiance entre les membres de l’équipe,
- éviter les incompréhensions et communiquer efficacement,
- mieux gérer (voire anticiper) les conflits et/ou désaccords,
- rester assuré(e) en situation d’inconfort et développer votre assertivité,
- motiver et engager vos collaborateurs,
- adopter une attitude empathique,
- renforcer votre écoute active…
Gagnez du temps et de l’énergie
Imaginez que vous partiez en expédition dans le désert, avec un téléphone à moitié chargé, des pneus usés et une seule bouteille d’eau. Serait-ce raisonnable ? Et pourtant, certaines personnes agissent ainsi, en étant mal préparées.
Vous pouvez toujours vous autoformer en intelligence relationnelle, mais vous n’aurez jamais le recul nécessaire pour appuyer là où ça fait mal et donc pour progresser rapidement.
D’ailleurs, savez-vous quelles compétences relationnelles vous possédez déjà et quelles sont celles que vous auriez besoin de développer ?
Il est assez facile de trouver sur internet des conseils pour travailler son intelligence relationnelle soi-même. Mais le parcours est laborieux et nécessite une rigueur et une régularité que beaucoup peinent à maintenir sur le long terme. La plupart de ceux qui ont tenté l’expérience s’essoufflent très vite et abandonnent.
Le cheminement effectué avec des spécialistes du domaine sera plus efficient : être accompagné par des experts qui ont fait le travail préalable d’identification des points de progression vous assure une évolution tangible et plus gratifiante.
Le cadre d’une formation permet ce travail, car elle fournit les outils adéquats et les clés pour jalonner le parcours de réussites réjouissantes et motivantes.
Misez sur la pratique
Dans le cadre des formations Hominance, nous tenons à offrir un parcours de formation axé sur la pratique avec des exercices de différents types : réflexion collective ou individuelle, quiz, tests, mise en situation, exercices dynamiques (et ludiques), concours (de pitch par exemple…), etc.
Par ailleurs, nos formations en intelligence relationnelle sont très flexibles, car nous savons qu’au-delà de vos préférences sensorielles, votre personnalité fait que chacun d’entre vous a un style d’apprentissage de prédilection. Votre profil DISC détectera le vôtre, car rien ne lui échappe !
Chaque formateur – tous sont issus du monde de l’entreprise – vous oriente de manière factuelle et bienveillante, afin de vous aider à progresser. Les cas d’école rencontrés permettent d’illustrer concrètement les problématiques et leurs solutions.
À l’issue de votre parcours, vous recevrez un mémo des apports pédagogiques ainsi que le recueil des ateliers de co-construction réalisés (questionnement, argumentaires, objections, PAC, etc.).
Bénéficiez de tests »expert »
Il existe de nombreux tests pour mesurer l’intelligence relationnelle.
Comme vu précédemment, le prérequis à une formation, c’est l’évaluation des stagiaires en amont. Cette évaluation s’affine ensuite lors de la formation au cours des mises en situation et des différents exercices.
Concernant les tests d’analyse comportementale, nous utiliserons le classique DISC, mais aussi des mini-tests pour évaluer l’écoute active, la capacité à rester factuel, le test d’assertivité, le test des Drivers, le test des canaux sensoriels, etc.
Il est possible de trouver ces tests sur le web, mais ils ne sont pas vraiment « accessibles » ou n’ont pas vraiment d’intérêt sans un accompagnement éclairant.
Il est donc important de développer certaines compétences en les pratiquant régulièrement. Le must pour pouvoir progresser efficacement est de bénéficier de conseils précis et d’avoir des retours d’expérience spontanés et concrets. C’est là que les formations en intelligence relationnelle prennent tout leur sens.
Pour accompagner vos collaborateurs dans la sensibilisation à l’intelligence relationnelle (IR), pour mesurer à quel point une formation en intelligence relationnelle peut apporter de nombreux bénéfices à vos équipes comme à vous-même, retrouvez nos formations sur le site d’Hominance et sentez vous libre de nous contacter.
Vous souhaitez en apprendre un peu plus sur les mécanismes de l’intelligence relationnelle et leur impact dans le cadre des entreprises commerciales ? Retrouvez mes autres articles sur ce thème sur mon blog.

par Laëtitia Rudelle | Août 11, 2025 | Tous les articles
Dans un monde où tout s’accélère, où l’on répond plus vite qu’on ne réfléchit, ralentir peut sembler contre-productif. Et pourtant…
Combien de décisions avez-vous prises sous pression, dans l’urgence, sans même avoir le temps d’y penser vraiment ?
Combien de fois avez-vous validé quelque chose en réunion « pour avancer », avant de devoir revenir dessus quelques jours plus tard ?
Ralentir, ce n’est pas perdre du temps. C’est éviter d’en gaspiller.
Ce mois-ci, je vous propose de faire un pas de côté.
De remettre en question cette culture de l’immédiateté qui nous pousse à décider trop vite, trop souvent.
Et d’explorer, ensemble, comment le simple fait de ralentir peut transformer la qualité de nos décisions… et de nos relations.
???? Neurosciences, exemples concrets, rituels simples à mettre en place : vous allez voir que ralentir n’a rien d’un luxe. C’est un levier stratégique – humain, durable, et terriblement efficace.
Pourquoi décidons-nous (trop) vite ?
Parce qu’on a l’impression de ne pas avoir le choix.
Parce qu’un mail arrive, qu’un Slack clignote, qu’un client attend une réponse… et que dans ce flux continu, le réflexe l’emporte sur la réflexion.
On prend des décisions à la volée, on tranche « pour ne pas bloquer le reste », on avance – parfois au prix d’un recul salutaire.
Mais si on prend un instant pour regarder les choses en face, une vérité s’impose : la rapidité n’est pas toujours synonyme d’efficacité. Et encore moins de justesse.
Ce que disent les neurosciences : décider sous pression, un pari risqué
Décider vite, c’est souvent valorisé. Mais d’un point de vue cérébral, c’est loin d’être optimal.
Lorsque vous êtes sous pression – stress, fatigue, urgence – votre cerveau bascule en mode survie.
Ce n’est plus votre intelligence stratégique qui pilote, mais l’amygdale, ce petit noyau primitif chargé de détecter les dangers.
Résultat :
- Vous réagissez au lieu de réfléchir.
- Vous privilégiez les solutions connues, même si elles ne sont pas les meilleures.
- Vous écartez tout ce qui demande de sortir de votre zone de confort.
???? Bref, vous allez plus vite… mais vous voyez moins clair.
Pour retrouver votre capacité d’analyse, c’est une autre zone du cerveau qui doit reprendre la main : le cortex préfrontal.
C’est lui qui vous permet de prendre du recul, d’évaluer les options, d’envisager les conséquences à long terme.
Mais ce cortex-là a besoin de calme.
De souffle.
De temps.
Bonne nouvelle : quelques minutes de pause suffisent parfois à réactiver cette partie-là. Une respiration profonde. Une marche rapide. Un silence.
Et c’est tout un monde qui se rouvre à vous.
Décisions précipitées vs décisions réfléchies : ce que ça change, vraiment
Tout manager a déjà été confronté à une décision à prendre « tout de suite ».
Et sur le moment, répondre vite donne l’illusion de maîtriser la situation.
Mais cette illusion a un prix.
La décision prise trop vite
Julien, manager dans une boîte tech, reçoit un appel client un jeudi soir. Le client exige une livraison avancée de 10 jours.
Pas le temps de réfléchir, Julien dit oui.
Il raccroche, prévient l’équipe… et voit les visages se crisper.
Trois semaines plus tard :
- Le produit est sorti, mais bâclé.
- L’équipe est rincée.
- Et le client, malgré tout, est déçu.
Une décision rapide… mais mal calibrée.
La décision mûrie avec lucidité
De son côté, Sophie, dans une situation similaire, prend un temps d’arrêt.
Elle consulte son équipe, pose les vraies contraintes, et propose un délai ajusté.
Elle appelle le client, explique. Elle ne promet pas la lune – mais elle tient parole.
Résultat :
- L’équipe garde son énergie.
- La qualité est au rendez-vous.
- Et le client, rassuré par cette transparence, devient… un allié.
Une décision réfléchie. Plus lente. Mais bien plus performante.
Ce que ralentir change… pour toute l’équipe
Ralentir ne transforme pas seulement votre manière de décider.
Cela transforme l’atmosphère dans laquelle les décisions se prennent.
Quand un manager prend le temps :
- de réfléchir,
- de questionner,
- de dire « je reviens vers vous demain » plutôt que « on tranche tout de suite »…
…il envoie un signal fort :
Ici, on privilégie la justesse à la précipitation.
Et ça change tout :
Un climat plus serein
Les collaborateurs sentent qu’ils ne sont pas là pour courir en aveugle derrière des décisions arbitraires.
Ils savent que leurs points de vue comptent. Ça apaise les tensions, ça fluidifie les échanges.
Une culture du dialogue
En ralentissant, vous ouvrez un espace pour entendre les objections, les idées, les doutes.
Cela ne veut pas dire tergiverser. Cela veut dire co-construire.
Des solutions plus créatives
Plus on ralentit, plus on sort du réflexe. Et plus on donne une chance à des options neuves d’émerger.
C’est là que naît l’intelligence collective : dans le petit temps laissé entre une question… et sa réponse.
3 rituels simples pour ralentir (sans perdre le fil)
Ralentir, ça s’apprend. Et ça commence par des micro-changements concrets, faciles à intégrer dans votre quotidien de manager.
1. La pause consciente avant chaque décision clé
Avant de dire oui. Avant de valider. Avant de trancher.
Prenez… 60 secondes.
Levez-vous. Respirez. Faites trois pas. Ne faites rien d’autre.
???? Ce moment minuscule permet à votre cerveau de sortir du mode automatique et d’activer sa capacité d’analyse. C’est là que vous pouvez entendre ce que votre intuition vous souffle, au calme.
Astuce : créez un code d’équipe
Par exemple : “On se prend 2 minutes ?”
Instaurer ce réflexe dans votre collectif permet de ralentir sans culpabiliser.
2. Se poser les 3 questions de lucidité
Avant de prendre une décision sous tension, demandez-vous :
- Est-ce que j’ai toutes les infos ?
- Est-ce que je suis en train de décider sous stress ou émotion ?
- Quelles seront les conséquences dans 2 jours, 2 mois, 2 ans ?
???? Trois questions simples, puissantes, qui freinent le réflexe… pour mieux activer la conscience.
3. Ouvrir un espace de réflexion partagée
Osez dire en réunion :
“Prenons 10 minutes pour y réfléchir, on en reparle juste après.”
Ce mini temps collectif change la dynamique.
Il montre que la qualité prime sur la rapidité, et que chaque voix a sa place dans la décision.
À tester : les slow meetings
Une fois par mois, programmez une réunion avec moins de sujets, plus de temps, et un vrai tour de table. Résultat : moins d’agitation, plus de cohérence – et des décisions durables.
Conclusion : Et si ralentir devenait votre nouveau réflexe stratégique ?
Dans un monde qui valorise la vitesse, ralentir demande du courage.
C’est choisir d’écouter avant de répondre.
C’est assumer le temps de la réflexion, là où tout pousse à réagir.
Mais c’est aussi ce qui fait toute la différence entre un manager sous pression… et un leader lucide.
Ralentir, ce n’est pas renoncer à la performance – c’est en poser les fondations durables.
???? Ce mois-ci, je vous propose un défi simple :
À chaque fois que vous sentez l’urgence monter… faites une pause.
Prenez une respiration.
Posez-vous une question.
Ouvrez l’espace du recul – même brièvement.
Vous verrez : la qualité de vos décisions, de vos relations, et de votre management… n’en sera plus la même.
Et vous, avez-vous déjà testé un rituel de ralentissement dans votre quotidien professionnel ?
Partagez vos retours d’expérience en commentaire et retrouvez la vidéo du mois sur ma chaine Youtube pour aller encore plus loin sur ce sujet essentiel.

par Laëtitia Rudelle | Juin 11, 2025 | Performance relationnelle
Un lundi matin. Réunion hebdomadaire en visio. Le manager partage l’ordre du jour, mais l’équipe reste silencieuse. Personne n’ose intervenir. Lui, de son côté, se crispe : “Ils ne s’investissent plus…” Lui n’a rien dit. Eux non plus. Mais tout le monde a “communiqué”.
Ce genre de scène, apparemment anodine, est le quotidien de nombreuses équipes. Et elle illustre parfaitement un principe fondateur de la communication humaine :
« On ne peut pas ne pas communiquer » – Paul Watzlawick
Cela signifie que toute action, tout comportement, même un silence, est perçu comme un message. Et en entreprise, ce message implicite peut être interprété très différemment de l’intention initiale. Un silence devient suspicion. Un regard évité devient rejet. Une non-réponse devient offense.
Le sujet est sensible – et fondamental – car il touche à ce que l’on appelle la communication implicite : celle qui ne passe ni par les mots, ni par les slides, mais par tout ce qui se joue entre les lignes.
Le cerveau ne supporte pas le flou
Face à un silence, à une absence de réponse ou à un comportement ambigu, le cerveau humain ne reste pas inactif. Il cherche à interpréter, combler, comprendre. Ce phénomène est profondément ancré dans notre fonctionnement biologique.
Les neurosciences sociales nous montrent que notre cerveau déteste les vides. Lorsqu’il est confronté à une absence de signal clair, il active plusieurs zones :
- L’amygdale, générant une vigilance émotionnelle accrue,
- Le cortex préfrontal, mobilisé pour tenter d’interpréter,
- Le système limbique, qui convoque souvenirs et émotions associées.
L’amygdale, par exemple, réagit de manière instinctive face à un silence ambigu, déclenchant un sentiment d’alerte, voire de menace sociale. Le cerveau, n’ayant pas suffisamment d’informations explicites, entre dans une phase d’interprétation automatique. Ce processus repose sur nos expériences passées, nos schémas cognitifs, nos émotions du moment.
Et dans cette recherche de sens, il projette :
- « Il ne m’a pas répondu = il est indifférent. »
- « Elle ne regarde pas la caméra = elle me juge. »
- « Personne ne réagit = ils s’en fichent. »
Ces interprétations ne sont pas neutres. Elles génèrent des micro-stress, du repli, une distance émotionnelle. Et cela finit par fragiliser la qualité des liens dans l’équipe. Ces micro-tensions sont perçues de façon inconsciente comme des menaces relationnelles, ce qui entraîne une baisse de la collaboration, un repli sur soi ou une défiance accrue.
Ces réactions sont amplifiées dans des contextes incertains, stressants ou numériques : le silence prend plus de poids lorsqu’il n’est pas compensé par une présence physique rassurante. La distance renforce le besoin de lisibilité, de signaux clairs, d’attention partagée. Le cerveau cherche de la cohérence. Lorsqu’il ne la trouve pas, il crée des histoires. Et ces histoires influencent les comportements.
Tout comportement est communication
Watzlawick, avec l’École de Palo Alto, a mis en lumière un principe puissant : même l’absence de communication est un acte communicatif.
En entreprise, cela se traduit ainsi :
- Un délai de réponse long peut être perçu comme du désintérêt.
- Une posture fermée en réunion peut être interprétée comme de l’agacement.
- Une caméra éteinte peut susciter de la méfiance.
La communication non verbale – qui regroupe les gestes, les postures, les expressions faciales, les silences – constitue en réalité une part immense de notre communication globale.
Autrement dit, même si l’intention est neutre, le message reçu peut être tout autre. Et dans des contextes émotionnellement chargés ou peu sécurisants, ces signaux sont amplifiés.
Un collaborateur qui reste silencieux lors d’un tour de parole peut vouloir éviter de s’imposer, mais son attitude sera perçue comme un désengagement. Une responsable qui lit un message sans répondre tout de suite peut simplement être absorbée ailleurs, mais ses collègues y verront de la froideur ou du mépris. Ce décalage permanent entre ce que l’on pense exprimer et ce que l’autre comprend alimente malentendus et frustrations.
Quand la perception remplace l’intention
Le vrai enjeu n’est pas ce que vous pensez dire. C’est ce que l’autre comprend. Et cette perception est influencée par son propre passé, son stress, ses croyances, son humeur du moment.
C’est ainsi qu’une même attitude peut produire mille lectures. Et que sans clarification, une communication neutre devient source de malentendus. Cette distorsion est encore plus marquée quand les liens de confiance ne sont pas suffisamment solides. Dans les équipes jeunes, en tension, ou dans les périodes de transformation, la communication implicite devient un terrain glissant. Tout est amplifié. Tout est interprété. Et très souvent : à côté de la plaque.
Les biais cognitifs accentuent encore cette mécanique. Le biais de négativité, par exemple, nous pousse à accorder plus de poids aux signaux perçus comme menaçants qu’aux signaux neutres ou positifs. Ainsi, un simple silence peut peser plus lourd qu’un mot gentil exprimé la veille.
Dans certaines cultures d’entreprise, le non-dit est la norme. Mais quand il devient permanent, il fragilise la confiance. Il installe un climat de prudence, freine les interactions et complique la coopération.
Les risques d’une communication implicite mal gérée
Des tensions non dites s’accumulent Des malentendus créent de la distance La méfiance s’installe dans les non-dits Les collaborateurs se protègent en se retirant
Et tout cela sans cri, sans conflit ouvert. Juste une série de signaux faibles non adressés. Les conséquences peuvent aller loin : démotivation, désengagement, perte de performance, voire départs évitables. Le climat relationnel est un actif fragile. Et l’implicite mal géré en est l’un des plus grands risques.
Psychologiquement, cette accumulation silencieuse crée ce que l’on appelle de la dissonance cognitive. Les individus ressentent un décalage entre ce qu’ils vivent et ce qu’ils perçoivent devoir montrer. Cela provoque stress, perte de motivation, voire des réactions de défense passive ou agressive.
Clarifier l’implicite : une compétence managériale
Le rôle du manager, ce n’est pas seulement de guider l’action, c’est aussi de gérer les échanges invisibles. C’est apprendre à donner du sens à ce qui ne se voit pas – et à ouvrir des espaces où chacun peut le faire aussi.
C’est pourquoi la métacommunication devient essentielle : « Je prends un temps de recul, je vous reviens demain » « Je ne suis pas en retrait, je suis juste concentré·e » « Ce silence n’est pas un désintérêt »
Ces clés verbales réduisent les interprétations, rassurent, et renforcent la confiance. Elles permettent de verbaliser ce qui, autrement, aurait été interprété de manière biaisée. C’est une hygiène relationnelle simple, mais puissante.
Les approches psychologiques contemporaines insistent de plus en plus sur la notion de sécurité psychologique, définie par Amy Edmondson comme un climat dans lequel chacun se sent libre de prendre la parole sans craindre de jugement. Cela passe par la capacité du manager à réguler les implicites, à nommer les signaux faibles, à encourager la parole vraie.
7 pratiques concrètes pour cultiver une communication consciente
- Nommer vos silences Expliquez ce que signifie votre absence de réaction : concentration, fatigue, délai. Cela rend l’implicite plus lisible.
- Mettre en place une météo émotionnelle Un mot pour décrire l’état d’esprit du jour en début de réunion. C’est rapide, mais très efficace.
- Clarifier les règles de communication Quels canaux ? Quels délais ? Quels rituels ? Ces balises rassurent, évitent les attentes irréalistes et réduisent le flou.
- Exprimer vos intentions « Mon objectif est de faire avancer, pas de critiquer. » Cette simple phrase peut désamorcer une défensive inutile.
- Demander des retours sur la communication « Comment tu as reçu ce message ? » Cela ouvre un espace de clarification, évite l’accumulation de malentendus.
- Accorder des temps pour parler de vos modes d’échange Un point mensuel : ce qui fonctionne / ce qui pourrait évoluer. Cela professionnalise la relation.
- Privilégier une réponse imparfaite à un silence Un « Je te reviens plus tard » vaut mieux qu’une absence de message. L’intention exprimée rassure toujours plus que le silence.
En résumé
Vous communiquez tout le temps. Par vos mots, vos regards, vos silences. Même sans parler, même sans répondre, vous êtes entendu·e. En prendre conscience, c’est retrouver un pouvoir : celui de clarifier, d’humaniser et de renforcer les liens dans vos équipes. La communication implicite n’est pas un ennemi : elle est un langage, qu’il faut apprendre à décoder, à nommer et à maîtriser. Et elle commence par vous.
Et si, cette semaine, vous testiez une métacommunication de plus ?
Si vous avez besoin d’aide, contactez-nous.